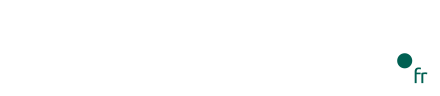Les bibliothécaires vous proposent une petite sélection de films documentaires à retrouver dans notre catalogue !
L’envers d’une histoire : un siècle yougoslave, de Mila Turajlié. 2019
Dans un appartement de Belgrade, une femme nettoie une serrure. De l’autre côté de la porte, une partie de son ancien logement réquisitionné sous Tito. Tel est le point de départ de ce documentaire poignant retraçant un siècle de l’histoire autrefois yougoslave, désormais serbe. La réalisatrice converse avec sa mère dans son intimité et dresse, par touches sensibles, le portrait d’une grande dame engagée. Celle-ci a tout vécu : le communisme, l’avènement et la chute de Slobodan Milosevic, les bombardements de l’OTAN, l’éclosion fragile de la démocratie. Elle n’a jamais cessé de se battre pour ce qu’elle croyait juste et se livre à sa fille avec des mots beaux à pleurer sur l’engagement, la liberté, la peur de renoncer. Ses paroles sont un appel à ne jamais courber l’échine, même si le combat doit être sans fin recommencé. Alternant images d’archives et scènes de la vie quotidienne où sa mère a du mal à tenir en place, le film prend tout son sens, raconte comment les événements font les hommes, les femmes, les écrasent ou les grandissent. C’est un hommage sensible à un peuple qu’on a peut-être jugé trop vite dans son ensemble, en oubliant que parmi les loups des individus n’ont jamais fini de résister.
Marianne Peyronnet
De cendres et de braises, de Manon Ott, en collaboration avec Grégory Cohen. 2018
Portrait d'une banlieue ouvrière en pleine mutation, De cendres et de braises donne à la parole aux habitants de la cité des Mureaux, près de l'usine Renault-Flins. Un récit ordinaire, au pied des tours de la cité ou à l'entrée de l'usine, Fabienne, Jamaa, Momo et les autres racontent et se construit peu à peu l'histoire d'une banlieue populaire.
Manon Ott, sociologue et cinéaste a passé près de dix ans à sonder la mémoire des habitants des Mureaux, banlieue à l'ouest de Paris. De nombreuses années pour alimenter ses recherches et dresser le portrait de ce lieu chargé d'histoires de luttes et de combats des ouvriers de l'usine Renault-Flins. Un récit lié également à la politique migratoire de la France, la cité a été construite pour héberger les différents flux d'une main d’œuvre indispensable à l'expansion de l'usine Renault.
Un documentaire politique et poétique, filmé en noir et blanc, qui intègrent de nombreuses documents archives. Des images des grèves de 68 ou en des suppressions de postes de 2011 apportent une force supplémentaire au sujet. Malgré quelques longueurs, De cendres et de braises, film subversif et engagé, reste un film rare, un autre regard sur la banlieue, loin des clichés habituels. Ces chroniques ont également pris la forme d’un livre à découvrir.
Paulette Trouteaud Alcaraz
Le Temps des forêts, de François-Xavier Drouet. 2018
Le film nous propose de pénétrer les mystères du travail des forestiers et offre dans le même temps une vision sans concession de la mono culture qui sévit en France et qui a pour conséquence de détruire l’écosystème naturel de nos forêts. Tout au long du film, quelques forestiers impuissants présentent le résultat du productivisme à outrance qui amène les entreprises de bois à ne planter que des sapins Douglas, en lieu et place des chênes présents autrefois, réputés pour pousser vite et donc faciliter le rendement. Le travail des énormes camions écrasant tout sur leur passage, allant jusqu’à polluer l’eau des cours d’eau est un véritable choc pour le spectateur. Le résultat est édifiant pour certains forestiers interviewés qui déplorent des sous-bois où rien ne pousse, des alignées militaires de sapins, des chants d’oiseaux disparus, des forêts entières transformées au fil du temps en plantations pour faire du bois Du plateau de Millevaches (où vit le réalisateur) en passant par le massif du Morvan jusqu’aux forêts de pins landaises, les paysages subissent les mutations dues à ce qui est considéré par certains comme de la mal forestation crée dans le but de concurrencer au maximum les pays d’Europe du Nord dans une guerre économique sans merci. Primé dans de nombreux festival le film a cependant fait scandale à sa sortie dans le milieu des forestiers. Et nulle réponse ne semble apparaître encore ce qui rend ce film, sorte de bouteille jetée à la mer, d’autant plus poignant.
Cécile Corsi
Amal, de Mohamed Siam. 2017
Amal a 14 ans lorsqu'elle participe aux premières manifestations de la place Tahrir, en Egypte. Déterminée, elle veut lutter contre les injustices dans son pays. Rien ne la décourage, pas même les violences policières qu'elle subit. La mort d'êtres chers ne diminue pas sa force et sa volonté. Elle est de tous les combats. Pourtant elle est une fille et sa place n'est pas toujours là où elle voudrait. Son désir de liberté est plus fort que tout. Durant cinq ans, la caméra la suit, partage ses joies et ses peines. Elle accompagne son évolution et son passage à l'âge adulte dans une société avant tout faite pour les hommes.
Ce documentaire dévoile l'identité d'une Egypte post-révolutionnaire à travers le destin d'une jeune fille rebelle et volontaire. Le printemps arabe vu du côté des femmes et des enfants, un regard inédit est dévoilé dans ce film. En inscrivant son projet cinématographique dans la durée, du début de la révolution égyptienne, de janvier 2011 jusqu’en 2017, Mohamed Siam aspire à nous montrer comment les jeunes Égyptiens se sont fait voler leur révolution. Ils se sont battus jusqu'à sacrifier leur vie. Des images d'archives ponctuent son propos révélant la violence de l'armée et de la police face au peuple. Le personnage Amal, espoir en arabe, est le fil conducteur de l'histoire récente de cette jeunesse sacrifiée. Une jeune fille hors du commun se comportant comme un garçon qui croit à son destin. Mais sera t-il si différent dans une Égypte où l'avenir des femmes semblent si figé. Pourtant, le portrait d'Amal est un début d'espoir. Une héroïne pour raconter les soubresauts d'un pays, c'est déjà une « petite révolution » en soi. Ce documentaire a été interdit en Egypte.
Paulette Trouteaud-Alcaraz
Quelle folie ! de Diego Governatori. 2020
Deux amis issus de la même école de cinéma : l’un passe derrière la caméra, l’autre devant. L’objectif : tenter de faire un film sur la difficulté du langage, sur l’autisme qui affecte Aurélien le personnage principal.
Avec un sujet aussi délicat, à la lecture du scénario, on serait tenté de passer à côté. Quelle erreur se serait…Le film de Diego Governatori est un petit chef d’œuvre d’intelligence et de sensibilité. On s’accroche les cinq premières minutes avant de plonger dans le monde intérieur d’Aurélien et passer presque inconsciemment de l’autre côté du miroir. Dès le début du film, le personnage erre dans un paysage aride, un no man’s land d’éoliennes fouettées par le vent avant d’arriver dans les rues grouillantes de Pampelune en plein cœur des ferias. Et c’est tant la parole débordante et non contrôlée du jeune homme que cette arrière fond saisissant qui finissent par se superposer pour ne faire qu’un et amener finalement le spectateur à une question existentielle fondamentale : où se situe la normalité ? La vision d’une foule saoule emporté par les taureaux, cuvant sa bière au milieu des détritus est saisissante, métaphore d’une folie tellement « ordinaire ». L’énergie produite par les éoliennes contiendrait-elle plus de sens que ces jeux ancestraux débiles ? Et les tentatives désespérées d’Aurélien de vouloir être au plus près d’un comportement social normal se trouvent contrebalancées fortement par ces images pleines de bruit et de fureur. Ne seraient-elles pas finalement les symboles tant à la fois de cette violence verbale que tente de nous faire comprendre le personnage que d’une certaine vision de la stupidité humaine ? Et c’est dans cet habile jeu de miroirs où l’on se retrouve aux portes de la compréhension que se situe le tour de force du film.
Cécile Corsi
La cravate, de Mathias Théry et Etienne Chaillou. 2020
Bastien, vingt ans, visage rond, à peine sorti de l’enfance, vit à Amiens. En rupture avec sa famille, un passé trouble de skinhead, il s’engage en politique auprès du Front National. De par son soutien, il gravit rapidement tous les échelons et endosse très vite les attributs de la respectabilité : le costume et la cravate.
Quatre ans après « Le sociologue et l’ourson », le film « La cravate » explore le parcours d’un jeune militant du FN peu de temps avant la présidentielle de 2017. L’originalité de ce documentaire repose essentiellement sur sa construction et sa mise en scène. Bastien apparaît assis dans un fauteuil face à la caméra. Il lit le scénario pendant que des images illustrent son propos. Une stratégie qui pousse le protagoniste peu à peu à se dévoiler et à analyser son parcours et ses choix face aux réalisateurs. Aucun jugement n’est porté par ces derniers. Ils nous révèlent juste un jeune homme et aux illusions perdues face à son désir d’ascension au sein du parti, qui comprend peu à peu qu’il ne correspond plus aux soucis de respectabilité de ce mouvement.
Paulette Trouteaud Alcaraz
Cassandro The Exotico, de Marie Losier. 2018
La documentariste Marie Losier s’est spécialisée depuis plusieurs années dans les portraits de réalisateurs et artistes plutôt issus de la culture underground. Ce film-là met à l’honneur la vie folle et pathétique à la fois de Saul Armendariz, plus connu sous le nom de Cassandro The Exotico ! Véritable diva, Cassandro a la particularité d’être transexuel. De ses loges à ses lieux de match, il nous entraîne dans un tourbillon d’énergie à paillettes. Sous l’œil de la caméra complice, nous assistons à sa minutieuse préparation entre rouge à lèvre rose tendre, faux cils ravageurs, poudre de riz et parfum bon marché. Tout est « too much » ! Cassandro fait des clins d’œil, prend la pose, embrasse la caméra, bref, il en fait des tonnes, lui la vedette sur le retour dont on sent le manque affectif. L’affect, il en a trouvé en la personne de la réalisatrice peut-être un peu trop occupée à lui sussurer des mièvreries qu’à donner au film une réelle dimension. On la sent visiblement trop dominée par son sujet et c’est là le hic. Reste un portrait pour le moins touchant d’un athlète aux innombrables fêlures et que la vie n’aura pas épargné (maltraitance, alcool, drogue). La rédemption est donc passée par le catch mais à quel prix ? Cassandro, en exhibant presque avec fierté ce corps qui part en miettes ne pressent-il pas qu’il préfigure le sombre destin d’un athlète qui se refuse encore à raccrocher ?
Cécile Corsi
Itinéraire d’un enfant placé, de Ketty Rios Palma. 2019
Placé en famille d’accueil depuis la petite enfance, Yanie, 14 ans, s’apprête à la quitter. Myriam et Jacques prennent leur retraite. Un déchirement pour l’adolescent qui doit du jour au lendemain changer de famille, de cadre de vie. Dévoré par la peur, il va devoir affronter ce départ vers l’inconnu, vers une autre famille. En parallèle, sa mère, sortie de prison depuis un an, tente de le récupérer et d’obtenir sa garde. A la recherche d’un foyer stable pour se construire, Yanie peine à trouver sa place face à ces adultes qui décident pour lui…
Ce documentaire est un portrait émouvant et sensible. Rarement l’histoire d’un enfant placé en famille d’accueil n’a été évoquée avec autant de justesse. Un récit à hauteur d’enfant, filmé au plus près de Yanie. La caméra évolue avec discrétion pour mieux lui laisser la parole. Elle a su ainsi capter les moments douloureux de cet enfant tiraillé entre une mère pas en capacité de l’élever et des familles aimantes qui ne sont pas complètement les sienne. Il est « le fils de personne », un aveu poignant de Yanie face à la caméra. Un documentaire sans jugement mais qui n'esquive pas ce qui dérange, ce qui émeut, ce qui donne à voir des institutions et de la situation réelle de ces enfants « sans .famille »
Paulette Trouteaud Alcaraz