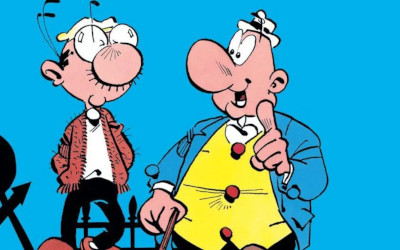
Fini de bruire
Aussi invraisemblable cela puisse-t-il paraître aux plus jeunes, pendant près de 100 ans, la bande dessinée fut avant tout l’affaire des magazines et des journaux, le bel album cartonné-couleurs n’étant réservé qu’à de rares élus dont le potentiel commercial tutoyait assez les cieux pour piquer les fesses de l’éditeur assis sur son nuage. Ainsi, chaque semaine ou chaque mois et ce jusqu’à la fin des années 70, des cohortes d’écoliers (et quelques écolières) retrouvaient-ils qui son Tintin, qui son Pif gadget, son Spirou, son Pilote, son Strange, son Blek le Roc ou quelque titre que ce soit parmi les dizaines qui peuplaient encore les kiosques en cette époque bénie. Plus tard, plus grand, ce serait L’écho des savanes, Fluide Glacial, Métal hurlant, (À suivre), d’autres encore, moins connus, plus éphémères, mais ce serait chaque fois la même chose : un rituel, un plaisir et la source inextinguible de souvenirs émus.
Qu’en reste-t-il aujourd’hui ? Rien ou presque rien : Le Journal de Mickey et Spirou, encore tout pâlichons d’avoir senti passer le vent du boulet, se retrouvent à peu près seuls côté jardin, flanqués côté cour d’un Fluide glacial sauvé par un lectorat particulier, différent en tout cas des autres titres de BD. Imaginez un petit bois charmant dessiné par Dany, victime d’une coupe rase où ne subsistent plus que de rares et maigres troncs calcinés dessinés par Hermann : c’est un peu glauque, c’est un peu triste mais c’est comme ça. Victime de la crise et de la désaffection du public, la presse BD a vécu. Qu’on le regrette ou non, cela ne la fera pas revenir, malgré les velléités périodiques de quelques nostalgiques de Pif le chien plus ou moins sincères.
C’est d’autant moins regrettable, après tout, que la BD n’est pas morte et même, si l’on en croit les chiffres, qu’elle a retrouvé ses bonnes joues. Après avoir connu quelques années noires, elle aura su se relancer dans les années 90, s’inventer un autre modèle économique, cette fois-ci basé sur l’album, sans prépublication. Le manga venant à la rescousse, ses affaires sont à nouveau florissantes, le spectacle peut continuer.
Et pourtant, toute nostalgie mise à part, quelque chose manque, quelque chose a disparu, qu’on peine à identifier et dont l’absence se fait néanmoins sentir. Ce quelque chose, c’est une rumeur, un bruit de fond, celui-là même qu’on n’entend jamais si bien que quand il s’est tu. Sourd, indistinct, il était fait des centaines de voix des centaines de personnages auxquels, sans même l’avoir voulu, se trouvait confronté le lecteur de magazines. C’étaient les voix des Chevalier Beloiseau, des Archibald Razmott, des Ivan Zourine, des Zingari, des Mr. Magellan, des Max l’explorateur, des Docteur Justice, des Taka Takata, des Aymone et des Brelan de Dames, des Wen, des Domino, des Centaures et de toute la troupe des sans-grades qui, sans toujours accéder à l’album (sinon parfois sous la forme un peu humiliante de l’album souple !) n’en mêlaient pas moins leurs voix dans le grand concert de la sérendipité. Comparses éphémères des séries à succès, stagnant le plus souvent au bas des référendums, ces troisièmes couteaux disposaient pourtant dans le journal d’une exposition identique et contribuaient à part égale à l’élaboration d’une culture.
Pas seulement d’une culture commune. Bien sûr, en un temps où les rédactions faisaient tout pour fidéliser leurs lecteurs, ceux-ci savaient se reconnaître entre eux à quelque signe mystérieux : gadget, houpette ou chapeau de groom. Quand la famille était coco, on était plutôt Pif, plutôt Tintin-Spirou quand elle était catho, les trois quand elle était riche et, pour les pauvres, il restait toujours les BD de gare et les Pieds Nickelés de chez le coiffeur. De quoi nourrir la conversation, quoi qu’il en soit, et disputer à l’infini dans les cours de récré.
Mais au-delà du lien social qu’elle savait si bien tisser, la presse était aussi et surtout le lieu privilégié d’une imprégnation, le creuset d’un apprentissage accéléré de l’image séquentielle tel qu’on n’en saurait rêver de plus efficient. Ainsi, le trop jeune lecteur de Pif pouvait-il découvrir Corto Maltese dès 1970 et faire semblant de l’avoir toujours aimé lorsqu’il le retrouvait sept ans plus tard dans (À suivre). Tous les exemples ne sont pas si prestigieux, loin s’en faut, mais cela n’a pas d’importance : ce qui compte, c’est la diversité – de styles, de genres, de contenus et de niveaux de lecture – auquel était exposé n’importe quel lecteur d’un magazine quelconque.
Qui est aujourd’hui assez riche pour se payer un tel luxe ? Le prix moyen d’un album interdit évidemment à la plupart des amateurs, surtout jeunes, de se gaver comme l’abonné lambda pouvait se le permettre en mordant à belles dents dans son club-sandwich hebdomadaire. Seules les bibliothèques publiques peuvent encore prétendre à jouer ce rôle. Du moins faut-il qu’elles offrent un choix suffisamment éclairé et diversifié, nonobstant l’appauvrissement dramatique de la BD jeunesse dont nous avons déjà parlé. De plus, le parcours du lecteur en bibliothèque ne saurait relever que d’une démarche volontaire laissée à sa seule et souvent défaillante curiosité. Le grand avantage des magazines fut toujours de ne pas permettre au lecteur de choisir : des rédacteurs-en-chef intelligents le faisaient à sa place et dieu sait s’il y en eut dans les années 60 et 70, entre Yvan Delporte (Spirou), Claude Boujon (Pif), Greg (Tintin) ou René Goscinny (Pilote), pour ne parler que de journaux pour la jeunesse. Ce dernier, surtout, outre son œuvre de scénariste, restera dans l’histoire de la bande dessinée pour avoir su faire de Pilote – journal encore assez conventionnel lors de son lancement en 1959 – un véritable laboratoire de création tous azimuts, où le classicisme et l’expérimentation voisinaient en bonne intelligence au sein d’un sommaire qui, aujourd’hui encore, laisse rêveur et l’œil humide le plus endurci des amateurs. Des délires baroques de Lone Sloane aux sarcasmes sociétaux de Cellulite, de Tanguy & Laverdure à l’antimilitarisme quasi psychédélique du Sergent Laterreur de Touïs et Frydmann, de l’onirisme d’un Fred, de l’humour absurde d’un Mandryka à l’aimable satire des « actualités » vues par Alexis, Chakir ou Pélaprat, Pilote demeure un sommet inégalé de diversité bien comprise, dès lors que Goscinny eut toujours le flair, primo, de ne jamais écouter les lecteurs (« Le jour où ce seront les lecteurs qui décideront du contenu du journal, je n’aurai plus qu’à prendre la porte » disait-il en substance pour justifier son horreur des référendums) et, secundo, de publier des choses qu’il n’aimait pas forcément mais dont il savait reconnaître le potentiel (à la différence d’un Hergé, par exemple, pour qui à peu près tout devait ressembler à Tintin dans Tintin).
Toutes ces voix, jusqu’aux plus minoritaires, trouvaient à s’exprimer sur un même pied dans un journal qui, de concert avec les autres, formait alors une vaste vitrine démocratique de la BD du temps. Tout cela bruissait d’une vie que ne remplacera jamais la quiétude d’aucune librairie, d’aucune bibliothèque, même la mieux achalandée. La vitrine a baissé le rideau. Pour qu’une BD soit lue, elle doit désormais compter sur la chance (un peu), la critique (beaucoup) ou la publicité (passionnément). Avec ses milliers de parutions annuelles, la bande dessinée peut à bon droit donner l’impression d’une jungle inextricable. Mais c’est une jungle étrangement silencieuse, où les livres sont seuls, isolés les uns des autres et retranchés sous une couverture soigneusement bordée. Une jungle endormie, en somme, une forêt qui coince la bulle.
Yann Fastier
