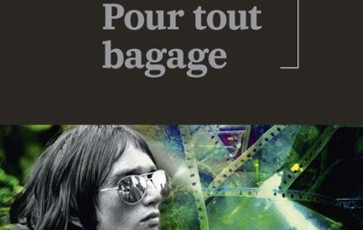Elles étaient six sœurs, portant chacune un nom de fleurs –Aster, Rosalind, Calla, Daphne, Iris et Hazel.
Au moment où débute le récit, seule Iris a survécu. C’est donc par ses mots que l’on découvre l’histoire des filles Chapel et que l’on comprend, au cours de cette vaste saga familiale débutant dans les années 50, comment elle a réussi à fuir la malédiction frappant les femmes du clan.
Le destin semble s’acharner sur la lignée. Belinda, la mère, erre dans la grande maison victorienne au nom évocateur du gâteau de mariage. Assaillie par les fantômes victimes des armes à feu Chapel, fabriquées par la manufacture de son époux, terrassée par le souvenir des hurlements de sa mère morte en lui donnant le jour, elle n’est qu’une ombre, dérangeante. Il n’y a qu’Iris pour croire à son mauvais présage, qui enjoint ses filles à ne pas se marier, sous peine de mort. Ce qui ne manquera pas de frapper les sœurs, les unes après les autres.
Roman à suspense, à tiroirs, conte gothique avec ses fantômes et ses cadavres enterrés dans le jardin, fable où la nature étaye les événements de senteurs florales ou d’effluves fétides, récit de vie féministe enragé, Les voleurs d’innocence questionne avant tout la place des femmes dans une société bourgeoise sclérosée à une époque que l’on souhaite révolue. Sarai Walker choisit la métaphore, tout en émaillant son histoire de force détails prosaïques, afin de renforcer son propos en évitant moraline et clichés. L’étrange prend ici une puissance qui surprend et émeut. Le mystère permet au lecteur de broder, de remplir les non-dits d’une dentelle ajourée et de se faire une opinion aussi résistante que du fil de fer barbelé.
Les femmes sont les victimes, certes, de cet enfermement que sont le mariage, la maternité, de cette négation de leur individualité qui les prive de toute émancipation. Mais l’auteure n’éreinte pas ses personnages masculins. Elle suggère plus qu’elle n’assène. Point de scènes de viols, de violence dans ses pages. Hormis le titre, rien ne sous-entend une maltraitance manifeste. C’est qu’elle est partout, insidieuse, et qu’elle agit de façon presque douce sur le destin des héroïnes. En opprimant leurs véritables désirs. En leur indiquant quoi penser et quoi dire. En les privant d’exprimer leur créativité, à travers l’art notamment.
La mort symbolique des femmes prend la forme d’une réalité terrifiante. Néanmoins, preuve de sa longue vie, les souvenirs d’Iris s’étalent sur plusieurs décennies. Si son père est parvenu à faire taire les hurlements de Belinda en internant son épouse à l’asile, il échoue à réduire au silence sa dernière fille. Parsemé de vers d’Emily Dickinson ou de Tennyson, hommage à peine voilé à la peintre Georgia O’Keeffe, le roman de Sarai Walker, avec ses multiples interprétations possibles, thèmes et références pourrait bien avoir comme maxime : s’exprimer ou mourir.
Marianne Peyronnet