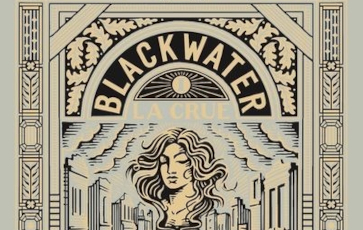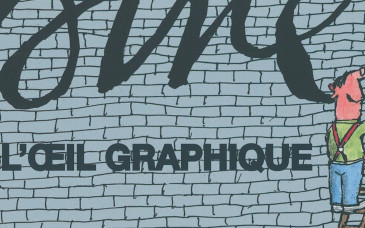On enjolive nos souvenirs, on se les crée, on feint d’en oublier, pour qu’ils collent mieux à l’image qu’on se fait (ou qu’on veut donner) de nous-mêmes.
On les emprunte à d’autres, on les déforme, intentionnellement ou non. Nos souvenirs sont nous-mêmes, une parcelle héritée de notre histoire familiale, des morceaux de nous que d’autres ont vécus et qu’ils nous ont racontés. Notre mémoire serait-elle fiable s’il s’agissait de raconter qui on est ? Les épisodes choisis, ceux que l’on pense constitutifs de notre personnalité, auraient-ils seulement existé ?
Rob Roberge tranche d’entrée. Apprenant qu’il risque de perdre progressivement la mémoire suite à diverses commotions cérébrales et abus en tout genre, il décide de faire le tri dans ces bouts de lui qui ont fait l’homme qu’il est devenu, tant qu’il est temps. Et il annonce la couleur : les faits relatés seront ceux d’un Menteur.
Roberge n’est pas n’importe qui. Dépressif, suicidaire, bipolaire, alcoolique, accro à toutes les substances qui croisent sa route, ses souvenirs sont, plus que chez quiconque, fragmentaires, évasifs, indignes de sa propre confiance. Il l’avoue avec sincérité : « Quand sait-on qu’un junkie ment ? Quand il ouvre la bouche. »
Roberge est surtout un écrivain extraordinaire. On le savait depuis Panne sèche, entre autre, roman paru à la Série noire. Les mots sont beaux quand il les met ensemble, et la construction de son récit est ici tout sauf insipide. Il raconte au présent, en se mettant en scène par un « tu » qui t’aspire ; il mêle, dans le désordre, anecdotes de l’enfance, détails d’hier, ou ces histoires avec les femmes qui ont compté un peu, beaucoup, passionnément. Il enchevêtre les périodes, revient sur certains événements, s’en éloigne, y revient encore. Tour à tour attachant, agaçant, drôle ou désespérant, il donne à lire son âme. Une âme bleue. Quelqu’un à ce point-là sensible, qui se juge si durement sans jauger ses semblables, se sentant si coupable de faire souffrir les gens qu’il aime mais ne pouvant s’en empêcher, n’est pas, malgré le titre, un menteur. Il n’affabule pas, ne s’apitoie pas, ne cherche pas à attendrir. Ou si peu. Ou pour une simple raison, désarmante : « Dans l’ensemble, tu t’inquiètes à l’idée que le monde te déteste autant que tu te détestes toi-même, et tu préfères inventer un personnage qui est plus intéressant que toi. (…) Tu ne mens pas, comme d’autres, pour gagner de l’argent ou dans l’idée de tirer quelque profit matériel – tu mens, comme d’autres, car tu redoutes énormément d’être seul. Que quelqu’un apprenne la vérité. Si personne ne sait réellement qui tu es, alors celui que tu es vraiment ne pourra jamais être rejeté. »
Autoportrait sans concession, sa bio ressemble plus à un exercice d’autopunition, pendant des mutilations qu’il s’inflige, un mea culpa irrésistible, une quête de rédemption, qu’à une volonté de dissimuler ou de taire. Il ne s’épargne pas. Au travers de scènes d’une sincérité Bukowskienne, il parvient comme personne à dire la peur de la décrépitude, la difficulté à s’aimer, à trouver sa place. Ce qui fait la grandeur de l’être humain n’est pas la perfection mais la pleine conscience de ses tares et Roberge nous console, un peu, de nos propres bassesses.
Marianne Peyronnet