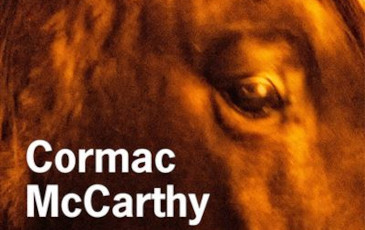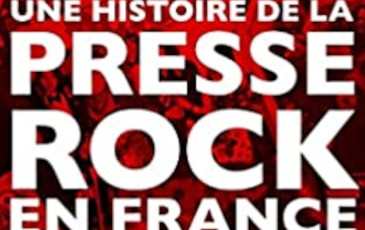Earl Haack Junior aime l’ordre, quand tout est bien à sa place, que rien ne dépasse.
Il s’emploie, avec zèle, à éliminer la vermine, faire disparaître les taches. C’est papa qui lui a transmis ce faible pour la purification, et Junior est en voie de dépasser son maître dans l’art du nettoyage. Earl n’est pas femme de ménage, il est shérif. Ses outils ne sont pas le balai et l’aspirateur, mais le .45, la hache et parfois le Destop. Les saletés qu’il éradique ne sont pas la poussière ou les cancrelats, mais les petits trafiquants, les délinquants, tous ceux qui se dressent en travers de sa route et l’empêchent de mener la belle vie. C’est lui le chef. Après tout, on est venu le chercher, parce qu’il a ses méthodes, acquises alors qu’il bossait pour les stups, à Denver. On l’a appelé à l’aide, alors que son père crève d’un cancer, dans cette petite ville du Nebraska où il a grandi, le long de l’autoroute de la drogue. On l’a élu.
Earl n’est pas un psychopathe. Il est logique, lucide et déterminé. A devenir le boss incontesté de son territoire, le parrain de tous les trafics rentables. Earl n’est pas là pour être aimable. Il est répugnant, expéditif. Il est aussi mélomane, amoureux. Il est étrangement troublant.
Roman noir radical, tordu, douloureux, L’ordre des choses, dont la traduction a été « naturellement » confiée à Sébastien Raizer, dérange, parce qu’il ébranle notre vision du monde, ne porte en lui aucune notion de rédemption, et qu’il fascine pourtant. Sidérés comme un lapin dans les phares d’une voiture et qui reste au milieu de la route en attendant le choc, on assiste hébétés à des scènes de torture insoutenables, incapables de détourner le regard. Alors oui, on peut voir dans L’ordre des choses une parabole de la dégénérescence de notre humanité. On peut y lire un questionnement sur notre capacité à confier à des « shérifs » notre sécurité, à fermer les yeux tant que notre confort est assuré. Mais c’est avant tout une œuvre perturbante, qu’on lit avec ses tripes.
Marianne Peyronnet