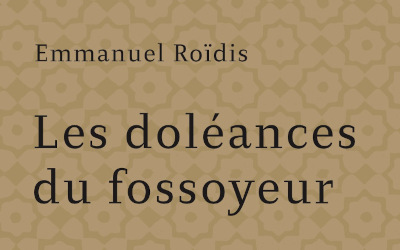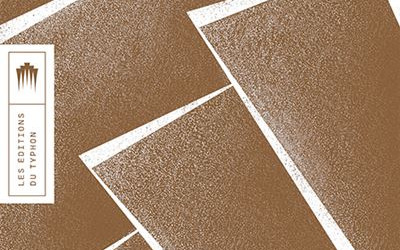Deux sœurs se retrouvent en Dordogne pour vider la maison familiale suite au décès de leur père.
Agathe est scénariste et new-yorkaise d’adoption. Partie très jeune aux États-Unis, elle revient au pays pour la première fois depuis longtemps, se remet mal d’une fausse-couche et n’aime pas spécialement être là, face à Vera, la sœur aphasique qui a grandi sans elle et qu’elle ne connaît plus.
Après Vladivostok Circus (Zoé, 2020) on ne retrouve pas sans plaisir la voix discrète d’Élisa Shua Dusapin dans le concert toujours un peu tonitruant de la rentrée littéraire. Une voix dont la justesse surprend tant le thème, a priori rebattu, pouvait susciter de méfiance. Or, loin des clichés, elle en tire un récit à la fois riche et personnel, évitant les pièges en douceur et se dispensant de recourir aux pénibles paroxysmes des règlements de comptes familiaux. On ne hausse guère le ton, chez Élisa Shua Dusapin, on ne casse pas trop la vaisselle : la catharsis, plutôt qu’imposée, advient presque naturellement, à force de persuasion, pour ainsi dire. Plutôt que champ de bataille, le roman se fait alors point de rendez-vous, où tout fait sens et conspire à réparer la relation d’Agathe et de Véra, mise à mal par la fuite permanente d’une narratrice aux phrases trop brèves pour n’être pas suspectes. Traîtresse à son serment d’être « toujours là » pour sa sœur handicapée, Agathe doit accepter de se confronter à elle-même pour se redécouvrir enfin féconde, dans une forme de renaissance, à la façon dont les vieilles pierres de la bicoque paternelle serviront à rebâtir un pigeonnier jadis ravagé par les flammes. De ce « vieil incendie » personne ne sait rien, sinon peut-être le défunt père, véritable clef de voûte du roman et passeur, par ses histoires et son érudition, de bon nombre d’autres mystères. Baignant dans une belle lumière automnale, ce roman du souvenir et du pardon est aussi celui d’une résurrection.
Yann Fastier