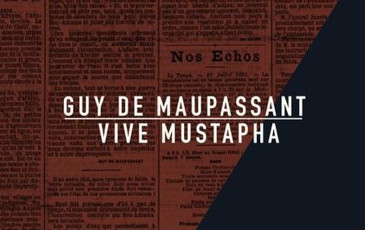Des monceaux d’ordures sur les trottoirs, des rats, des cafards qui se faufilent dans les lézardes des murs couverts de moisissures,
des voisins barricadés derrière des volets fermés, telle est la cité. Avant, les gens se parlaient parce qu’ils avaient encore l’espoir de pouvoir se tirer de là. Avant le Vietnam et le retour des vétérans qui ont ramené avec eux les pires désillusions. Avant les crises successives qui ont fini d’acculer les habitants au fond de leur gouffre. Depuis que la cité est devenue leur prison, que la misère, les drogues, les suicides, la violence sont partout, ils ne rêvent plus, ils sont simplement là, comme paralysés. Dans ce contexte, Donjie, qui revient chez sa mère Big Sue après un accident au cours duquel il a perdu ses jambes fait figure d’emblème. Il faut dire qu’il cumule. De retour chez lui, sa mère, qui ne sait partager avec lui que des joints, a vendu son lit et lui a réservé un coin par terre près du canapé. Il n’a jamais connu son père et Kevin, son grand frère, son modèle, le fuit, incapable de surmonter sa culpabilité d’avoir fait estropier son frangin. Seule Charlene, sa petite sœur, semble se préoccuper de son sort. Alors, à la recherche de son identité profonde, lui qui ne sait même plus son âge, se rappelant seulement qu’il doit être en âge d’aller au lycée, Donjie bouge. Victime des moqueries des gosses, se déplaçant sur les mains ou son skate, qualifié de monstre, il affronte le monde. D’abord dans les rues de son quartier, puis au-delà de la frontière, en ville, là où passent les bus et les camions poubelle, là où les gens sont aimables et respectueux. Les paralysés est le roman le plus dur de Richard Krawiec et la lecture s’effectue le cœur serré face à tant d’injustice, à une telle solitude, devant tant de noirceur. L’extrême pauvreté déshumanise. Les individus sont niés, uniquement considérés selon leur appartenance sociale, jugés en bloc. Toute une partie de la population, abandonnée par les pouvoirs publics, tente de survivre, tellement accablée, moquée, rejetée qu’elle ne sait plus aimer. Les mères reproduisent l’éducation qu’elles ont reçue et vendent leurs filles. Les pères ont quitté le navire. Les trafiquants rôdent et prospèrent. Tous les personnages se débattent. Tous sont en quête d’amour et Krawiec ne juge pas, il décrit. S’il y a peu de lumière, la beauté est toujours prête à surgir, fulgurante dans un sourire, un geste d’empathie qui laisse sur les genoux. L’humain est capable du pire – et certaines scènes sont extrêmement douloureuses – mais l’auteur ne renonce pas. L’avenir est possible. Si Donjie peine à lire les signes d’affection, il apprend. Il se questionne, sur la fraternité, la parentalité, et malgré son inculture, il avance. Certains quitteront la cité, malgré les discriminations dont ils sont victimes, à force de volonté, grâce à l’éducation ou à l’amour.
Marianne Peyronnet