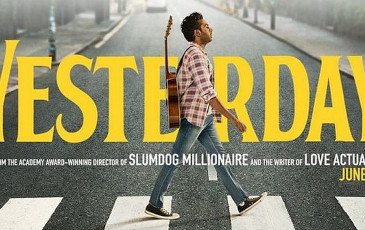La composition est presque abstraite, géométrique et, pourtant, c’est bien une chaise, un escalier, une église de campagne en bois, des fenêtres, un vieil arrosoir…
Ce n’est que cela, mais ça l’est entièrement, avec un air de vous dire qu’ils sont bien les derniers de leur espèce, laissés là pour préserver la mémoire d’un monde à l’abandon. Personne pour s’asseoir sur cette chaise, pour s’encadrer dans cette porte. Personne et, pourtant, jamais l’humain n’a été si présent. Ces choses-là ont servi, ce peigne aux dents cassées, cette vaisselle usée, rayée… Chacune de ces photographies bruisse de murmures et d’échos assourdis. Quelqu’un aura vécu là. Quelqu’un se sera assis là, quelqu’un aura franchi ce seuil et sera passé de l’autre côté.
Wright Morris est l’un des grands oubliés de la photographie américaine des années 30, celle de la Grande Dépression, celle des Walker Evans et des Dorothea Lange. Une même attention aux objets du quotidien, à l’usagé, au vernaculaire, capable de rendre poétique ce qui n’est pas fait pour l’être, et, pourtant, sa démarche est tout autre. Là où ces photographes agissent avant tout en sociologues, Morris cherche une forme d’intimité. Une simple chaise de bois, pour Evans, est le témoignage de la misère, de conditions économiques déterminées. La même, selon Morris, est un portrait : « Ces photographies ne sont pas des documents à caractère social : ce sont les portraits de ce qui persiste après que leur dimension sociale a été oubliée » avoue le photographe dans un Statement de 1947. Étonnamment chaudes et présentes derrière l’austérité d’une composition souvent frontale, aux contrastes puissants, elles ne sont pourtant a priori pas faites pour être vues de manière autonome. Le principal apport de Morris à l’histoire de la photo est en effet d’avoir voulu très tôt y associer le texte, dans un rapport qui, si indirect puisse-t-il paraître, n’en prend pas moins une nécessité singulière, énigmatique, parfois, mais toujours au-delà de toute idée de légende ou d’illustration.
Il en résultera deux livres : The Inhabitants, d’abord, conçu dès la fin des années 30 et qu’il ne parviendra cependant à publier qu’en 1946, bientôt suivi de The Home Place (1948). Malgré la faveur des critiques, l’insuccès commercial le poussera toutefois à se consacrer à la seule écriture pour ne revenir à cette forme originale qu’en 1968, avec God’s Country and My People, dans une optique plus directement autobiographique.
S’il est un écrivain reconnu dans son pays (deux foix récompensé d’un National Book Award, il n’a curieusement pratiquement jamais été traduit en français), son œuvre photographique n’a fait que récemment l’objet d’une redécouverte dont témoigne cette exposition et le livre qui l’accompagne. Présentées sans les textes d’origine, les photographies n’en restent pas moins de véritables blocs de poésie brute dont Robert Adams disait : « Ce sont des photographies à aimer. Leur sujet est en fait la caresse que les génération passées ont prodiguée aux objets avec lesquels ils ont vécu ». Une certaine façon également – et sans doute Wright Morris n’at-t-il jamais eu d’autre motif – d’interroger doucement la mémoire sur ce qui fonde une identité, sur ce que c’est qu’être Américain, sans drapeaux ni trompettes.
Yann Fastier