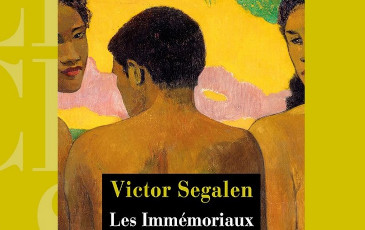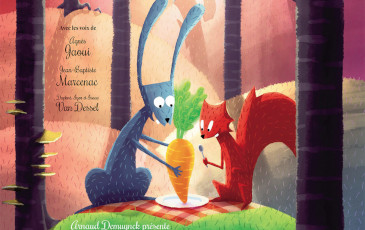Un camion. Une route à l’écart du trafic. Un soleil de plomb.
Peut-être le Mexique. Gros et Vieux se relaient au volant. Ils ont interdiction de s’arrêter, pas même pour pisser, seulement pour faire le plein. Ils doivent mener leur cargaison à bon port, c’est-à-dire loin. Les 157 cadavres sont bien alignés, dans des sacs en plastique noirs, dans la remorque réfrigérée. Il faut rouler, toujours, ordre du Commandant. Le Gouverneur craint pour sa réélection. Ces morts, on ne sait plus où les mettre, les morgues, les chambres froides, les cimetières débordent. Ces morts, décapités, flingués ne doivent exister pour personne, symboles de l’échec d’une politique sécuritaire qui n’a fait qu’amplifier le chaos.
Les dépouilles du fourgon sont anonymes. Gros et Vieux aussi. On apprend d’eux au fil du voyage, porté par un style presque sans respiration, étouffant, au rythme des kilomètres avalés, des pensées des comparses exaltées par les amphéts qu’ils s’enfilent pour ne pas sombrer. Ils n’ont pas grand-chose à se dire, coincés dans l’habitacle asphyxiant, solidaires par obligation. A mesure, ils gagnent en identité, en humanité peut-être, secoués, réveillés par les morts qu’ils ont eux-mêmes causées, avant. Le Vieux a perdu sa fille, elle le hante jusqu’à l’obsession. Le Gros a la larme à l’œil, tatouage qui prendra vie.
L’intrigue est mince. Elle suffit à écraser. Des péripéties sur une voie sans issue. Un auto-stoppeur, archéologue étranger, dont la rencontre est aussi incongrue que ses recherches dans un pays voué à la violence, sans autre certitude pour quiconque qu’une disparition rapide et proche. Un voleur désespéré. Des narcos, des militaires. Des coups de feu. De nouveaux morts. La puanteur de la charogne. Une fin somptueuse, avec la poésie comme expression ultime, avec le Mictlan, le lieu des morts, au bout.
Marianne Peyronnet