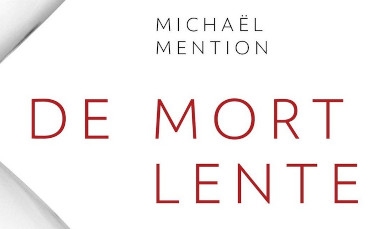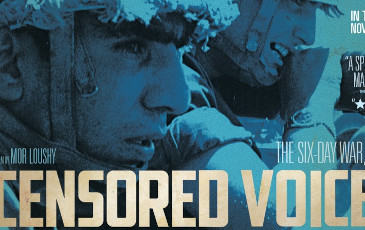Certains arbres laissent mieux passer la lumière que d’autres.
C’est sûrement le cas de ce peuplier carolin (Populus Carolinensis), poussé par hasard près de la maison natale de l’auteur à Chacabuco, province de Buenos Aires, tant ce recueil de nouvelles semble traversé de clartés diversement colorées selon l’heure et l’humeur du jour. Qu’il s’agisse d’évoquer l’oncle Agustín, fou de course à pied, les amours du timide señor Pelice, le plus célèbre artificier de la région ou bien le destin brusquement écourté de Basilio Argimón, commun à bien des hommes volants de son espèce, l’ensemble de ces récits baigne dans cette même lumière chaude que la tendresse associe au souvenir. Car s’il fut voyageur, pilote, marin, journaliste, professeur et mille autres choses, Haroldo Conti, toute sa vie, ne cessa jamais de revenir vers les siens, vers ce village, cette maison aux murs d’argile, au toit de tôle rapiécé, toutes racines intimement mêlées à celles de son arbre tutélaire, dont on ne sait précisément jusqu’où elles s’étendent, à quelles régions du cœur elles aboutissent. Nulle nostalgie béate, cependant, dans cette attention aux petites choses, aux objets les plus modestes, une azalée dont « les fleurs à la peau violette tremblent, délicates, sous le vent inquiet de septembre », une scie à onglet dans la pénombre de l’atelier de l’oncle menuisier, une cage en fil de fer… C’est que les choses, à force, « finissent par avoir plus de mémoire que nous » et qu’il est du devoir de l’écrivain de ne pas seulement témoigner des grands fracas du monde, mais d’être également là pour ceux dont « (…) personne ne saura jamais rien si ce n’est par le truchement de ce vieil artifice. » C’est également pourquoi il ne faut rien voir de disparate dans un recueil qui fait suivre une poignée de contes pleins de fantaisie par une série d’hommages à quelques amis bien réels, comme la vieille Julia Lafranconi, gardienne solitaire de l’île de Juncal, sur le fleuve Parana, « parmi les arbres, les joncs et les cabiais » ou bien les Urugayens persécutés par la junte militaire alors au pouvoir. Ce très beau texte, Tristesses de l’autre rive, date de 1975. Un an plus tard, le 4 mai 1976, Haroldo Conti était enlevé à son tour par les sbires de la dictature argentine. Emprisonné, torturé, il fait partie jusqu’à ce jour des quelques 30 000 « disparus » imputés à l’armée au pouvoir de 1976 à 1983. Au recueil initial l’éditeur a voulu adjoindre une nouvelle supplémentaire, la dernière de l’auteur, terminée le jour même de son enlèvement. Intitulée A la droite de Dieu, elle témoigne admirablement de la double inspiration qui préside à La Ballade du peuplier carolin, entre célébration émue de l’amitié et transfiguration fantaisiste du souvenir : n’y assiste-t-on pas à l’arrivée au ciel de la douce et discrète Tante Teresa, à la droite de Monsieur Dieu, qui en profite pour organiser en son honneur un asado du feu de Lui, où le tout Chacabuco d’outre tombe croise sans s’en étonner quelques chanteurs qui « bien que vivants, (…) ont l’âme vagabonde », à l’image du poète Juan Gelman et du musicien Juan Cedrón, en rupture de Cuarteto. Partager une côtelette avec le Créateur de la côtelette en personne : quelle plus belle façon de refermer un livre si authentiquement fraternel qu’il vous ferait presque aimer l’humanité ? Précédemment paru en français en 1984, La Ballade du peuplier carolin était absent depuis bien longtemps de nos étagères. Osera-t-on – timidement – suggérer à La dernière goutte de transformer l’essai en faisant suivre cette belle réédition par celle de Mascaro, chasseur des Amériques, dernier roman de Haraldo Conti, dans lequel on retrouve d’ailleurs une bonne partie des personnages du présent recueil ?
Yann Fastier