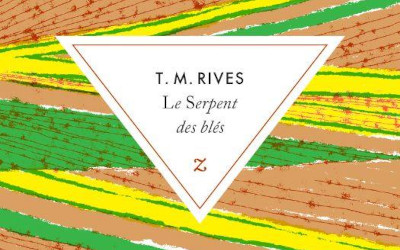Zero K, c’est le degré 0 de l’échelle de Kelvin, soit -273,15 ° C, la température la plus basse qui puisse exister, en-deçà de laquelle on cesse définitivement de dîner en terrasse.
C’est aussi la température idéale à laquelle on conserve les morts en vue de leur résurrection ultérieure. Le milliardaire Ross Lockhart est le principal actionnaire d’un centre de recherche sur la cryogénie des êtres humains. Condamnée à brève échéance, sa jeune épouse subit le processus de mort artificielle qui lui permettra d’attendre que la science ait suffisamment progressé pour assurer sa guérison. Mais la vie, pour le vieil homme, perd alors tout son sens, il choisit de devancer l’appel et de l’accompagner dans la mort.
Maintenant que la science-fiction voit la plupart de ses thèmes rattrapés au grand galop par la réalité technologique, la littérature générale s’en empare avec une dilection toute particulière et les moyens qui lui sont propres. Non que la SF ait toujours été incapable de faire œuvre littéraire, loin de là – il n’est que de lire Kurt Vonnegut, Philip K. Dick, Antoine Volodine et pas mal d’autres pour s’en assurer – mais la simple histoire du genre l’a longtemps rendu tributaire du roman d’aventure, avec ses codes et, parfois, ses limites, idéologiques ou stylistiques.
Aussi, lorsqu’un écrivain du calibre de Don DeLillo choisit de se frotter aux thèses très controversées du transhumanisme, on peut s’attendre à ce que le résultat ne tienne pas plus de La guerre des étoiles que d’Hibernatus. Nulle posture pseudo-scientifique, nulle documentation pesante ne nous est infligée : chez DeLillo, c’est la mélancolie qui tient lieu de technologie. Une technologie qui « est désormais une force de la nature. Nous ne la contrôlons pas. Elle souffle sur la planète et nous ne pouvons nous réfugier nulle part. » Jeffrey, le narrateur, fils d’un premier mariage de Ross, porte le récit sur des épaules qu’on devine un rien voûtées par ce constat. Indécis et fier de l’être, enclin à l’introspection, il ne cesse de s’interroger sur ce qui le rattache et le sépare de ce père dont il s’acharne à ne pas suivre l’exemple tout en s’interdisant de le haïr. En témoin curieux et vaguement révulsé, il cherche avant tout à comprendre la signification de ce lieu « situé dans les lointains confins du plausible » où l’a fait venir son père pour assister à son départ. Semé de sculptures énigmatiques et d’écrans où ne cessent de défiler des images d’apocalypse, il tient bien plus au fond de l’œuvre d’art contemporain que du laboratoire scientifique. Une œuvre totale, aussi bien représentation qu’interrogation du réel, mortifère et glacée, à laquelle Jeffrey ne trouve à opposer qu’une ancienne passion pour la langue et le pouvoir qu’elle détient sur les êtres et les choses. Deux conceptions du monde, donc, et de l’homme qui, dans sa finitude, pourrait bien n’avoir pas besoin des artifices de la technique pour accéder à un au-delà de lui-même. Ainsi la mort de sa mère projette-t-elle Jeffrey dans un « déferlement de tristesse et d’affliction qui me fit comprendre que j’étais un homme augmenté par le chagrin (…) cette découverte que le dernier souffle d’une femme permet à l’humanité contrainte de son fils de s’exprimer ».
Si d’aucuns jugeront encore que les grands livres de Don DeLillo sont derrière lui et qu’il ne livre plus désormais que des romans « intéressants », d’autres, dont nous sommes, trouveront qu’il n’a rien perdu de sa puissance pour avoir su ramasser son propos. S’achevant sur une apothéose lumineuse qui annule d’un seul coup toutes nos prétentions trop humaines, Zero K pourrait bien représenter à cet égard l’une des plus belles leçons de doute que pouvait nous donner l’un des plus vivants écrivains de la littérature mondiale.
Yann Fastier