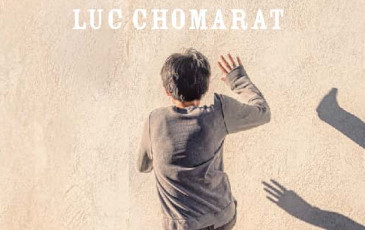« Adolf Hitler m’a sauvé la vie. »
Dès les premières lignes d’Avenue nationale, vous êtes prévenus. L’auteur ne va pas vous caresser dans le sens du poil et le politiquement correct ne sera pas de mise ici. Un personnage parle, tutoie son auditoire, l’apostrophe, l’engueule presque. Qui est-il ? Vandam. Un type qui emprunte son surnom à l’acteur belge, parce que, comme son héros, il fait 200 pompes par jour et qu’il s’entraîne dur, pour être prêt, au cas où, parce que « la paix n’est qu’une pause entre deux guerres », parce qu’on est à Prague et qu’on ne sait jamais. Cette guerre, il la souhaite Vandam, il est déjà dedans, en guerre contre les nègres, les Ukrainiens, les glandeurs, les gonzesses, les bridés, les punks, les pédés… Il est le dernier guerrier de la bataille de Teutoburg, an 9, unique légionnaire Romain survivant au massacre perpétré par les glorieux Germains. Alors, il a le droit de faire le salut romain, parce que c’est pas le salut nazi, même si ça y ressemble. Les raccourcis historiques, il connaît Vandam, ça l’arrange. Ça lui permet de clamer haut et fort sa vision du monde, de bien se faire comprendre, quitte à se répéter. Impossible de la lui fermer. Il déroule en boucle son discours simpliste et t’as intérêt à l’écouter, parce qu’il a le coup de poing facile. Et à qui s’adresse-t-il ? A son fils ? Ce fils de dix-sept ans à qui il apprend la vie, qu’il n’est pas censé voir, parce que quand on a fait de la taule, on n’est pas un exemple. A ses potes de comptoir ? Attablé la Severka, cette seule taverne dans cette cité du nord de la ville, tenue par Lucka, qu’est pas trop mal pour une nana de plus de quarante balais, il refait le monde, Vandam, soir après soir, imbibé de myslivec, le whisky local et sa logorrhée soûle. Il se rêve en cador et il n’est qu’un poivrot. Le passé le fascine parce qu’il peut l’arranger. Est-ce à toi qu’il parle ? Il te suce la moelle et tu ne peux t’empêcher de tourner les pages. Parce qu’il est troublant, et qu’il dévoile, en creux, par petites touches, son histoire pathétique. Parano, violent, ex camé. Bourreau ou victime ? Le système n’aide que les riches. Lui n’a pas eu de chance. Jamais là où il fallait, et surtout pas sur cette fameuse Avenue nationale, ce premier jour de la révolution de velours, en 1989…
Avenue nationale est un roman brutal, sans concession. Par sa construction, tout en ruptures de ton, par les propos tenus par son personnage principal, il dérange. Après La fin des punks à Helisinki, Jaroslav Rudis continue d’explorer l’Histoire tchèque, sans faire de compromission, et il bouscule nos propres certitudes. Vandam est une victime pour laquelle il est difficile de ressentir de l’empathie. Il est trop loin dans son délire, trop abrupt. Et pourtant, il est capable de fulgurance et lucide par instants (« si tu t’endettes, t’as un avenir, parce qu’il faut que tu rembourses »). Il est vrai, palpable et vivant, emblématique des laissés pour compte, de ceux qui se sentent, à tort ou à raison, exclus du système. Son discours anti-politiciens, malgré son manque de nuances, est percutant, dans l’air du temps. A travers Vandam, Rudis dépasse les frontières tchèques. Il questionne l’avenir de l’Europe. Et ça, ça fiche la trouille.
Marianne Peyronnet