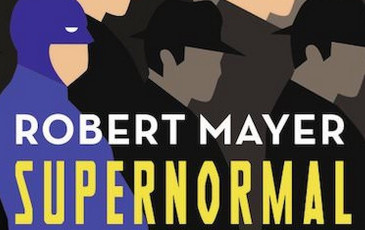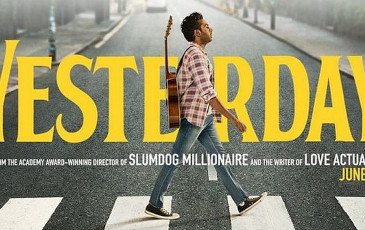Deux courts romans pour un hommage à la littérature de genre.
« Ils sont tous morts… Les cadavres de ceux que nous n’avons pas réussi à manger pourrissent patiemment dans la cale, entassés les uns sur les autres. » Belle entame (sans mauvais jeu de mots), incisive, non ? Le Providence, baleinier norvégien, était parti en mer le 12 septembre 1927. L’équipage était constitué de neuf hommes robustes. Ainsi que l’indique le titre Nous sommes tous morts, le lecteur sait, dès les premières phrases, qu’il n’y a eu aucun survivant. Un carnet a été retrouvé, dans lequel Nathaniel Nordnight, 25 ans, second à bord, se sachant perdu, livre ses confessions et narre l’épouvante a posteriori. Tempête, rêves atroces, brume, apparitions, glace qui fige le navire au milieu de nulle part, monstres, rations insuffisantes, faim, cannibalisme… Dans Camisole, Edgar Griffith, comptable dépressif, est mandaté pour aller vérifier les comptes de l’asile Cliffton, perdu dans les collines du Vermont. 418 fous dangereux sont internés, qui ne demandent qu’à s’échapper, avides de sang et de chair humaine. Un journal découvert après la mort de son auteur ; un homme seul qui sombre dans la folie, en proie à des hallucinations, à moins qu’il n’ait été réellement victime de forces démoniaques que même l’imagination ne saurait inventer ; la distorsion du temps et de l’espace ; des éléments déchaînés, la pluie, le vent, le gel qui privent le narrateur de toute échappatoire et l’enferment dans un endroit clos ; des ombres terrifiantes, des attaques fantomatiques, des morts qui marchent, la folie, la mort…. Salomon de Izarra revisite la littérature d’épouvante en s’amusant à intégrer dans ses récits tous les ingrédients propres au genre. Hommages non dissimulés au maître Lovecraft, ses romans évoquent jusque dans le style, de facture très classique, les chefs-d’œuvre de l’écrivain américain. Alors pourquoi ne pas lire l’original plutôt que la copie ? Parce que le jeune Français assume et n’affiche pas la prétention de se hisser à un tel rang. Et si ses histoires me semblent moins fouillées qu’un roman comme Noir Océan de l’Islandais Stefan Mani édité dans la Série Noire, ce huis clos oppressant fourmillant lui aussi de clins d’œil à Lovecraft, il n’en demeure pas moins qu’il parvient à créer une atmosphère dérangeante, qu’il livre de belles trouvailles, tant dans les détails (les visages qui se dessinent sur les vitres inondées de l’hôpital psychiatrique), que dans la forme (« Les limbes ont faim »).
Marianne Peyronnet