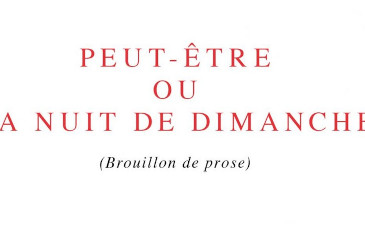Rachel Deville, décidément, travaille la nuit :
depuis L’heure du loup (L’Apocalypse, 2012), elle semble s’être fait une spécialité de ce genre relativement marginal qu’est le récit de rêve, dans lequel peu d’auteurs se sont d’ailleurs finalement risqués depuis ces grands dormeurs que furent Julie Doucet et David B. Avec les 14 récits de La maison circulaire, elle se hisse désormais à la hauteur de ses aînés et, forte d’une croissante assurance narrative et graphique, parvient à nous retenir dans l’univers tout en hachures et grisaille habité par son double quand bien d’autres s’y sont cassés les dents. Car, pour quiconque en a été victime de la part d’un de ses collègues, le récit de rêve, quel qu’il soit, tourne vite au cauchemar. Les images, les sentiments qui l’accompagnent sont à la fois si vagues, si intimes et si changeants qu’ils semblent presque impossibles à transmettre, le langage verbal s’avérant curieusement impuissant à rendre compte avec simplicité de l’expérience onirique. Or, la bande dessinée, comme dans bien d’autres cas (la pornographie, par exemple) se révèle un médium éminemment propice à ce type de récits : en prenant directement en charge un certain nombre d’éléments visuels qu’une longue et souvent vaine description peine à évoquer, elle fournit au rêve un décor, une ambiance propre à en soutenir le récit, à l’objectiver enfin d’une façon bien plus efficace et immédiate que les mots. Encore faut-il savoir s’y prendre : au-delà du seul contenu de ses rêves, Rachel Deville construit de véritables scénarios, de parfaite petites machines narratives où l’entrelacs mouvant des cases répond à l’objectivité délibérément froide du dessin pour guider le lecteur à travers le labyrinthe de son sommeil paradoxal. Sans interprétation ni explications, on pourrait juger l’exercice un peu vain, mais pas plus, au fond, et même plutôt moins que le dernier Astérix…
Yann Fastier