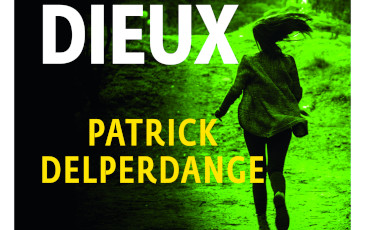Après André-la-Poisse, en 2021, les Éditions du Typhon poursuivent leur réédition d’Andréï Siniavski (1925-1997)avec Graphomanie et Le Verglas, deux de ses premières nouvelles, ici regroupées sous le titre C’est bien écrit !
Belle trouvaille, en vérité, puisqu’il peut s’appliquer, dans sa plaisante polysémie, à chacune des deux nouvelles comme au recueil lui-même, dont il se charge ainsi de faire la réclame pour pas cher tout en annonçant bien la couleur. Il y a comme ça chez Siniavski un fond d’autodérision qui met du rose aux joues de la grisaille. Graphomanes impénitents ou bien soudain doués d’une embarrassante omniscience, ses personnages ont toujours l’air de s’excuser de n’être que ce qu’ils sont tout en l’assumant avec l’irrésistible opiniâtreté des timides. « N’empêche que... » pourrait être leur devise : obsessionnel jusqu’au délire (« Même chez François Mauriac – je l’ai feuilleté en vitesse – j’ai trouvé quatre passages empruntés à une de mes œuvres de jeunesse »), le narrateur impublié de Graphomanie n’en est pas moins conscient de la vanité de sa marotte. N’empêche qu’il continue d’écrire. Celui du Verglas, fort d’un don qui lui fait absolument tout connaître de tout un chacun, n’en fait cependant usage qu’à son corps défendant et sans rien en tirer qu’un profit dérisoire. N’empêche qu’il est tout de même écrivain, comme Siniavski lui-même, à sa manière fraternelle et doucement têtue.
Est-ce cette force d’inertie qui fit craindre au pouvoir soviétique qu’il se tramât entre ces lignes quelque chose de vaguement narquois, d’autant plus redoutable qu’il ne le comprenait pas ? Toujours est-il qu’elles valurent l’exil à leur auteur, après sept années de camp de travail à régime sévère, comme une confirmation supplémentaire de l’universelle absurdité d’un système dont cet héritier de Gogol et de Hoffmann ne devait au fond pas trop s’étonner.
Yann Fastier