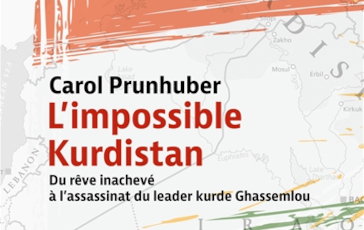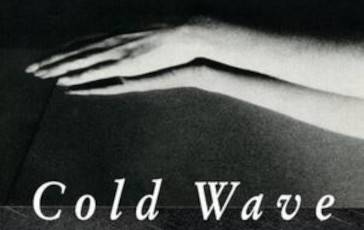Depuis un mois qu’il a pris ses fonctions dans le Nord-est de la France, le commissaire adjoint Keller peine à trouver ses marques.
De cette région où il débarque, il connaît l’histoire dans les grandes lignes. Effondrement de la sidérurgie dans les années 70. Un monde en friche avec son lot de laissés pour compte, chômeurs, déboussolés. Et conséquences qui vont avec, alcool, drogues, trafics en tous genres facilités par la porosité des frontières luxembourgeoise, belge, allemande. Les stigmates de la désindustrialisation sont visibles mais la compréhension des enjeux souterrains, des rapports de force à l’œuvre, dans l’ombre, sont inaccessible à l’étranger qu’il est. Ce n’est pas de Faas, l’inspecteur albinos censé le seconder, que viendra la lumière. Ambigu, insubordonné, ce dernier lui a fait comprendre d’entrée qu’il était le maître des lieux et comptait bien le rester. Alors, quand des meurtres à l’arbalète commencent à se multiplier, Keller se sent bien seul pour mener l’enquête. Dans le même temps, des travaux sur le crassier déterrent un cadavre momifié. Il s’agit du corps d’un syndicaliste disparu en 79. Ses fils, jumeaux que tout oppose, ont toujours cru qu’il les avait abandonnés. Dimitri se défonce au MantraX. Alexis fait fortune dans la Banque. La découverte macabre les oblige à renouer le contact, après des années.
A travers deux récits parallèles qui finissent par habilement se recouper, Sébastien Raizer fait se croiser des personnages qui, a priori, n’avaient rien en commun. Le procédé lui permet de dresser un panorama le plus vaste possible, de décortiquer la situation économique, sociale, politique de la région, sous tous les angles, et de livrer une analyse très fine des raisons qui ont mené au sacrifice de l’outil industriel local. Keller avance dans ses investigations et dans sa compréhension des enjeux de pouvoir, des choix historiques et de leurs répercussions en même temps que nous. Comme nous, il halète au rythme de ses découvertes. Comme nous, il bout.
Sous la canicule, l’atmosphère étouffante saturée de pollution, colle les chemises de sueur, épuise les organismes aussi sûrement que les hauts-fourneaux. De chaud, on bout.
Faas ne la ferme jamais. Toujours une bonne vanne à faire, une saleté à ajouter. Vicieux, arrogant, tête à claque assumée, on rêve de lui en retourner une, mais surtout pas qu’il la boucle. Dans le rôle du méchant, il dépasse les attentes. Il excelle jusqu’au bout et remporte la palme. Reparties qui font mouche et qui blessent, agaçantes et jouissives. Sale gueule et verbe haut, depuis longtemps on n’avait pas autant adoré détester un vilain. Avec Faas, d’énervement, on bout.
Mais surtout, Nuits rouges fait remonter à la surface quarante ans d’ignominie. Lâchage en règle du peuple par les politiciens quels que soient les gouvernements successifs, luttes intestines et collusions des syndicats avec le pouvoir, abandon des ouvriers, sacrifice de toute une région…
« C’est dans cette région qu’a été créé l’archétype de la crise, vers la fin des années 70, qui a ensuite été reproduit dans tous les secteurs industriels du pays, jusqu’au secteur public aujourd’hui (…) C’était il y a plus de quarante ans et c’est toujours la même crise. Et c’est toujours la même recette qui est appliquée pour la maintenir à un niveau à peu près tolérable (…) Après avoir été le laboratoire de l’archétype politique, policier, médiatique et social de la performativité de la crise, la région est devenue une zone d’expérimentation d’avant-garde d’humains inutiles. Nous sommes inédits, mec. Nous ne servons strictement à rien. Pas un seul d’entre nous. Nous sommes la société du futur. » Faas
De rage, on bout.
Marianne Peyronnet