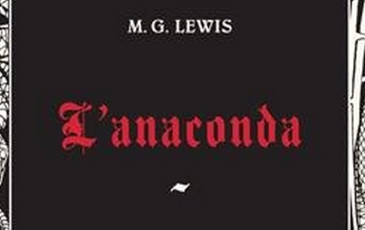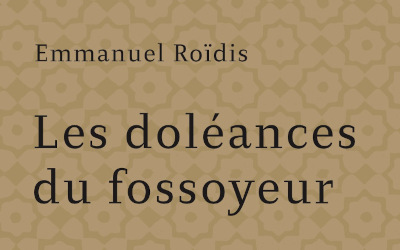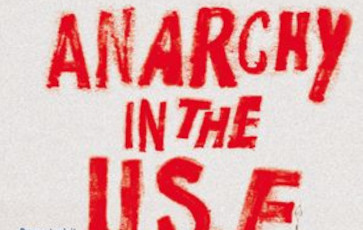Il y avait le Dostoïevski de Gide et le Genet de Sartre, il y aura désormais le Tchékhov de Tchoukovski.
Traduit pour la première fois en français, il prend instantanément rang parmi ces rares ouvrages de critique littéraire qui vous ouvrent une œuvre et la déploient sous vos yeux en une éclatante synthèse plutôt que de l’émietter façon puzzle en savantes et desséchantes analyses.
À la lecture, on apprendra pourtant bien peu de choses, et de l’homme et de l’œuvre. Peu d’éléments biographiques stricto sensu (pour une véritable biographie, on se reportera par exemple à Anton Tchékhov : une vie, de Donald Rayfield (Louison éditions, 2019)), presque rien sur le théâtre en tant que tel, par exemple, mais une telle passion qu’elle vous prend par la manche et ne vous lâche plus que vous n’ayez lu ou relu les trois volumes de la Pléiade.
Si peu qu’il soit connu sous nos longitudes, Korneï Tchoukovski (1882-1969) l’est surtout comme auteur pour enfants, l’un des plus grands qu’ait produit la littérature soviétique. Cela ne doit pas faire oublier qu’il fut aussi l’un des derniers représentants de « l’âge d’argent », cette génération qui fut celle des Akhmatova, des Blok, des Mandelstam ou des Biély, soit une modernité littéraire dont Tchékhov fut en quelque sorte le père. Ce livre, paru en 1967, vient donc en point d’orgue à une reconnaissance jamais démentie de la part d’un auteur qui avoue avoir pleuré tout la nuit, après avoir appris la mort de Tchékhov, « (…) avec un sentiment d’abandon et de tristesse que je n’ai plus jamais éprouvé en quatre-vingt-cinq années de vie ».
Cette relation quasi filiale, on la retrouve tout au long d’un ouvrage qui se veut d’abord un portrait visant à rétablir la vérité de l’auteur. Non, Tchékhov ne fut pas cette âme légère, indolente, que certains se plurent à décrire. D’une folle générosité, au contraire, d’une abnégation et d’un dévouement absolus, Tchékhov, sa vie durant, devait s’employer à « se dresser » lui-même selon un code moral dont il se réservait la rigueur, ayant au contraire pour les autres une indulgence dont toute son œuvre est imprégnée. À cet égard, son voyage à la rencontre des bagnards de Sakhaline est significatif. Déjà malade, il traverse toute la Sibérie sur de mauvais chemins pour se faire le porte-parole des parias de la société russe, expérience dont il rapportera un livre, L’île de Sakhaline, que l’on aurait tort de classer à part dans son œuvre.
Car, et c’est le second point de Tchoukovski, l’oeuvre de Tchékhov n’a pas été comprise par ses contemporains. Il souligne à l’envi combien l’on a peine à croire qu’un tel classique « ait dû travailler dans un contexte aussi hostile ». Toute sa vie, les critiques « libéraux », défenseurs d’une littérature engagée, virent en lui un adepte futile de l’art pour l’art, une âme froide, insensible aux malheurs du peuple. Pire, ceux qui le louaient en faisaient, eux, une sorte de chantre de la mélancolie, ayant reçu le don des larmes. Tchoukovski s’élève contre l’un et l’autre jugement. L’œuvre de Tchékhov, au contraire, est d’une humanité profonde et toute de compassion mais, d’une finesse inconnue dans la littérature « engagée » de son temps, elle fait avant tout confiance au lecteur et se passe de grandes déclarations. Pleine de réserve et de pudeur, son empathie s’adresse à tous ses personnages, qu’il n’idéalise ni ne diabolise jamais, et s’exprime à travers une véritable dialectique des images et dans une langue indépassable de sobre élégance et de précision.
Cette élégance, on la retrouve dans l’oeuvre du disciple, assortie d’un rare et communicatif enthousiasme, de ceux qui vous font décidément sentir que les meilleurs livres sont bien ceux qui vous donnent envie d’en lire d’autres.
Yann Fastier