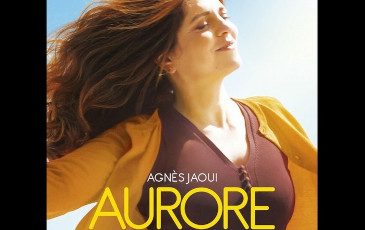Cette fois, c’est fini. Après Les nuits rouges et Mécanique mort, Sébastien Raizer avec Terres noires semble clore définitivement son cycle lorrain.
Ultime volet donc, d’une trilogie violente et désespérée qui s’avère indispensable à l’auteur pour parachever son implacable argument : le néo-libéralisme économique mis en place par les Etats-Unis conduit aux pires exactions, détruit tout. Dernier chapitre d’un récit mouvementé, « davantage un triptyque qu’une trilogie », nous dit l’auteur, avec pour thèmes successifs « la crise, le crime et la guerre, éléments structurels du capitalisme, devenus les piliers, puis la dynamique du libéralisme totalitaire américain. »
Le propos est complexe. Raizer ne prend pas ses lecteurs pour des imbéciles. Il facilite néanmoins la compréhension de mécanismes qui pourraient paraître abscons en plaçant certains de ses personnages, auxquels on a eu le temps de s’attacher, au sein des rouages du système. On se retrouve ainsi propulsé avec eux au cœur de ce que l’humain est capable de créer de plus dégueulasse, la guerre. Haine, vengeance, effroi. Les maux de la guerre s’abattent sur les héros, Dimitri et Luna en tête, et l’on souffre avec eux, avec une intensité rarement égalée.
Difficile ici, de parler de l’œuvre sans trop en dire. Terres noires comporte son lot de morts, de scènes atroces, de peine et de regrets. A la suite d’un Dimitri éperdu, en fuite ou aux aguets, on cavale, effrayé de connaître ce qui se trame sans pour autant ralentir notre lecture. Suspense haletant, sentiments en dent de scie. Horreur, amour, tristesse. Beauté fugace d’autant plus lumineuse qu’elle surgit au détour de l’épouvante. Calme pendant la tempête. Et retour au chaos. Raizer excelle à incarner, faire sentir, cultiver l’ambiguïté pour mieux éprouver, inventer la vraie vie vivante dans une galerie de personnages révélés à eux-mêmes par les circonstances. Femmes frêles et fortes, hommes victimes et bourreaux, détraqués, solaires et sombres, tous portent en eux les failles et la fureur qui font les vrais héros de la littérature. Avec cette capacité à surprendre. Comme ce Midget, nain déjanté, fantasmatique, digne d’une figure de Crews ou Lynch.
Cette fois, c’est fini. Ils vont (presque tous) nous manquer.
Marianne Peyronnet