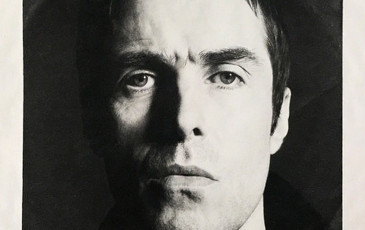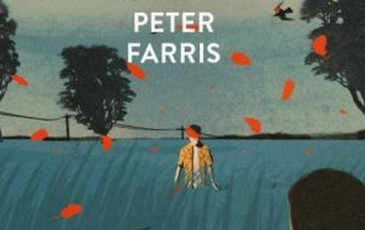Sans doute se trouve-t-il encore, dans quelque vallée perdue des montagnes du Balourdistan, l’un ou l’autre philistin pour ricaner à l’idée même de musique « répétitive ».
Née aux États-Unis à l’orée des années 60, la musique minimaliste, comme l’appellent plus volontiers les Américains, reste pourtant l’un des courants musicaux les plus féconds du XXe siècle. Loin de n’être qu’un épiphénomène, une mode sans lendemain, elle aura au contraire généré des ramifications dont on n’a pas fini de mesurer l’ampleur, non seulement dans le domaine classique mais jusqu’à l’ambient et l’électro. Aussi n’est-il pas toujours facile d’en définir le périmètre exact. C’est à quoi s’attache en premier lieu le musicologue et critique musical Renaud Machart dans ce petit livre à la fois clair et synthétique : la musique minimaliste, stricto sensu, est l’invention concomitante de quatre musiciens dont les travaux, se répondant entre eux et se fécondant dans un espace et dans un temps donnés, donneront lieu à un corpus d’œuvres désormais classiques, appelées à servir de référence : In C, de Terry Riley, Einstein on the Beach, de Philip Glass, Music for 18 musicians de Steve Reich… Travaillant chacun de leur côté, La Monte Young, Terry Riley, Philip Glass et Steve Reich prennent cependant racine dans un terreau commun, alimenté – pour faire vite – par le jazz, Satie, les expérimentations de John Cage et de l’école de New York et, surtout, par la découverte des musiques orientales, indienne et balinaise notamment. S’inscrivant en opposition au sérialisme dogmatique qui régnait alors sur la musique classique occidentale, ils prônent un retour à la tonalité qui, rendant soudain leur musique « accessible » au profane, provoquera l’ire de quelques mandarins, Boulez en tête, lesquels ne manqueront pas de s’étouffer sur le manque de sérieux et la facilité d’une musique condamnée dès lors à être plus souvent jouée dans les galeries d’art, les lofts d’artistes et les musées que dans les salles de concert officielles, d’où elles furent longtemps bannies. Musique facile ? Certains interprètes, pour n’y avoir pas consacré tout le temps nécessaire, s’y sont rapidement cassés les dents : car le temps est la grande affaire des musiques minimales, prêtes à l’étirer sur des longueurs jugées déraisonnables (jusqu’à 24 heures pour certains concerts), où la superposition et le subtil décalage de motifs simples finit par former un véritable tapis sonore, aux couleurs changeantes et constamment renouvelées sous couvert de répétition. Qu’elles jouent sur les bourdons ou sur les rythmes, les musiques minimales dessinent un volume où se déploient des harmoniques propices à l’oubli de soi, à une extase, comparable à celle que recherchent les derviches tourneurs soufis ou les confréries Gnaoua du Maroc. Si la neutralité de l’expression définit l’ensemble du corpus initial, le recours à la tonalité débouchera paradoxalement, s’agissant surtout de Glass, sur un étonnant retour de l’émotion – parfois jusqu’au cliché – via ses nombreuses contributions au cinéma. Cela pose évidemment la question de la postérité. Renaud Machart fait bien sûr la part belle aux disciples les plus notoires (John Adams, Michael Nyman, Gavin Bryars, Meredith Monk, Laurie Anderson…) mais aussi à de plus discrets comme Julius Eastman, Simeon Ten Holt ou Charlemagne Palestine. S’il exclut, pour des raisons qu’il explicite, les tendances « réductionnistes » (Morton Feldman et sa nombreuse descendance) et « mystiques » (Arvo Pärt, Henryk Górecki, John Tavener… jusqu’à Ellen Arkbro et Kali Malone), on regrettera bien sûr certaines impasses : rien sur Wim Mertens, Arnold Dreyblatt, Tony Conrad, Glenn Branca, Rhys Chatham ou même Max Richter. Qu’importe : il n’en faut pas davantage, au contraire, pour avoir envie d’aller plus loin et de continuer à explorer un univers à la fois fascinant et beaucoup plus accessible qu’on a parfois la paresse de le croire.
Yann Fastier