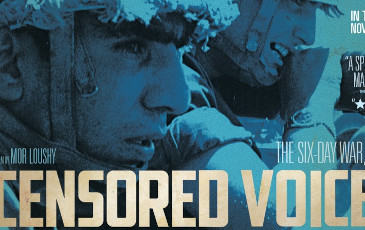Après une prime jeunesse fusionnelle, Ella et Martha, deux sœurs d’une vingtaine d’années,
s’en vont soigner leur dépression respective dans une petite station de la montagne norvégienne. L’hôtel est paradisiaque, l’hôtelière providentielle, la barmaid plus que séduisante et le crédit semble-t-il illimité. Cela devrait suffire, seront tentés de croire ceux pour qui Vénus avait autre chose à faire que de frôler des cyclamens le jour de leur naissance. Eh bien non : car les filles ne sont pas simples, loin de là, et se trouvent plus souvent ballottées par leur caprice que par le vent glacé qui souffle dans ce petit roman aussi couvert de neige que de prix dans son pays d’origine.
Mettons qu’il dise quelque chose de la sortie de l’enfance et de l’incertitude du désir. Mettons que ces deux-là soient ainsi comme retranchées du monde pour mieux tisser le cocon dont elles sortiront beaux papillons. Mettons même que, n’étant pas femme, nous ne puissions comprendre, il n’empêche que, trop riches, trop occupées d’elles-mêmes, Ella et Martha ne sont décidément pas nos copines. Si joli soit leur nombril, il est trop petit pour s’y noyer et si l’écriture, bien sûr, n’est pas elle-même en cause, elle confère au texte une sorte d’apesanteur qu’on se gardera de confondre avec la si désirable légèreté, malgré tout ce que peut en gémir une narratrice en plein transport lesbien : « Tout fanait autour de moi, tout fleurissait autour de moi. Le monde vacillait. Et bien que dans le même instant tout vienne brusquement à me manquer, tant ce que je possédais que ce que j’avais perdu, c’était si léger, si léger d’être enchantée ». Aussi le roman fonctionne-t-il, indéniablement, mais il fonctionne en vase clos, sans autre air, pourrait-on dire, que celui de ne pas y toucher. Un vase parfaitement lisse, donc, sous ses fêlures artistement peintes, et qui ne verse finalement rien d’autre qu’une version distinguée de l’eau de rose.
Yann Fastier