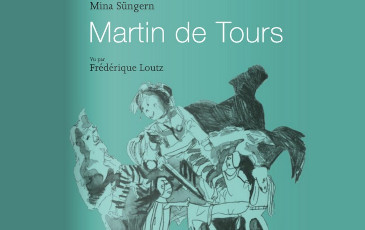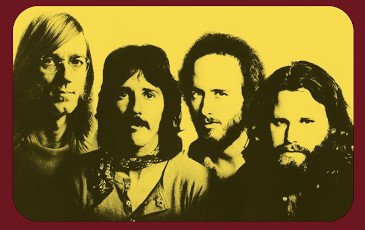Deux filles armées et casquées, à bord d’une antique moto-chenille allemande :
il y a fort à parier que cette seule image, sexy en diable, soit à l’origine de cette mini-série post-apocalyptique, la première du jeune mangaka Tsukumizu. La blonde Yûri et la brune Chito n’ont pourtant rien des pulpeuses gravure idols qui peuplent bon nombre de shônens. Engoncées dans de grosses parkas militaires, parfois réduites à l’état de schéma par un graphisme qui change de la vulgate habituelle du « style manga », elles touchent au contraire par leur fragilité – on pourrait presque dire leur ténuité – dans l’univers de métal et de béton dont elles sont parmi les rares survivantes. Où vont-elles, et pourquoi ? On ne le saura que progressivement, au fil d’aventures minuscules, égrenées sous forme de courts chapitres dans une atmosphère de mélancolie douce et résignée digne de Clifford Simak ou de Ray Bradbury. Là où le dessinateur occidental n’aurait pas pu s’empêcher de faire péter des trucs, de convoquer sectes étranges et zombies cannibales, le Japonais se contente de faire dialoguer sans fin ses rêveuses héroïnes, qui semblent toujours au bord du sommeil ou de l’épuisement et ne se chamaillent plus que par habitude ou par jeu. Aux antipodes d’une Tank girl en perpétuelle surchauffe, Girls’ last tour invente une science-fiction ouatée, où le murmure des filles accompagne le lent clac-clac des chenilles dans le silence presque pascalien de cette gigantesque et vertigineuse cité-usine dont elles remontent patiemment les étages, en quête d’une vérité qu’on redoutera jusqu’à la fin, déchirante.
On ne sait plus sur quel ton le chanter mais il faut dire et redire encore que le manga ne se réduit pas à One Piece et Naruto, qu’il est bien plus vaste et riche que ça, et produit encore actuellement ce qui se fait sans doute de mieux – en tout cas de plus désirable – en matière de bande dessinée mondiale, « indépendants » compris. Elu haut la main meilleure surprise d’une année 2020 qui n’en a pas compté que de bonnes, Girl’s last tour en est s’il en fallait une nouvelle preuve, par six.
Yann Fastier