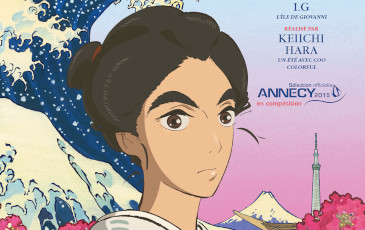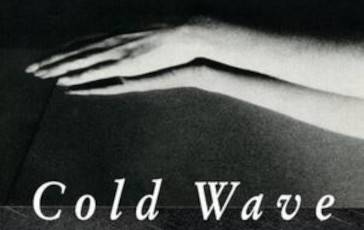Tom Kettle, 66 ans, ancien flic, file une retraite paisible dans un village à quelques encablures de Dublin.
Sur son siège en rotin, à l’écart du tumulte, il passe ses journées, solitaire, à admirer le paysage. Un soir, deux jeunes collèges de sa brigade viennent demander son aide sur une vieille affaire non résolue. « Pas ces putains de prêtres », se dit Tom, refusant de se replonger dans le passé.
La vie revient sous l’effet de la sonnette de sa porte d’entrée, d’ordinaire silencieuse, tuant son oubli. Tom est obligé de reconnecter ses souvenirs à la réalité, anéantissant le cocon psychique qu’il s’est forgé. Sebastian Barry fait « entendre » ses pensées. Idées passant du coq à l’âne, hésitations, non-dits, le lecteur fait le tri et, à l’instar du vieil homme, sent monter l’angoisse à mesure qu’il (re)découvre la vérité enfouie. L’horreur de l’évidence afflue, Tom a perdu tous ceux qu’il aimait, sa femme June, sa fille Winnie, son fils Joe. La souffrance du deuil, niée un temps, revient avec force. Ainsi que les éléments terribles de cette ancienne affaire qui se confondent avec ceux de sa vie. June a été violée quand elle était petite par des représentants de l’Eglise catholique, martyrisée en toute impunité comme des milliers de gosses livrés à de sombres pervers sexuels secondés par des bonnes sœurs serviles et cruelles. Destins brisés, traumatismes insurmontables commis par « des chacals, des serpents, des scorpions (…), des hommes répugnants, ineptes et sans scrupules qui n’avaient de cesse de faire le mal. »
Nous sommes dans les années 90. La découverte des monstruosités commises sur tant d’enfants pousse les autorités à enfin réagir, dans des procès retentissants qui bouleversent tout le pays, toute la structure sociale de cette Irlande soumise, où même les représentants de l’ordre, même les médecins, ont préféré baiser la main des prélats, « les archevêques des saloperies dévastatrices, » couvrant leurs méfaits, plutôt que défendre les victimes. La mémoire de Tom, orphelin lui-même élevé en Institution, revient, (lui) rappelant l’infamie, réveillant son deuil, l’absence insupportable. L’auteur agit avec délicatesse, par paliers, pour décrire l’effroi. A l’image du personnage principal, il procède lentement, comme si, avec trop de détails, il prenait le risque de lui faire perdre définitivement la raison. Tom est à la limite et c’est cette faille, cette possibilité qu’il se laisse sombrer qui le rend si attachant. Réfugié dans un monde qui n’existe plus que dans sa tête, il (re)prend conscience, parfois, de sa détresse. Sa douleur brise le cœur. Comment survivre quand on reste seul et que les monstres existent ?
Ponctuant le discours de Tom de « Doux Jésus », de « Dieu du ciel », Barry ne dit pas si c’est la force de l’habitude ou un reste de foi qui lui fait prononcer ces termes. Il ne dit pas si Tom a conservé sa foi en l’homme. Il émaille son récit de passages lumineux néanmoins. La nature dans sa beauté peut être un réconfort. Parler aux morts aussi. Les voir, comme le fait Tom. Les toucher, quand on a décidé de lâcher prise, ne plus souffrir, se laisser pénétrer par la douceur, dans un ultime élan, une joie enfin désespérée.
Marianne Peyronnet