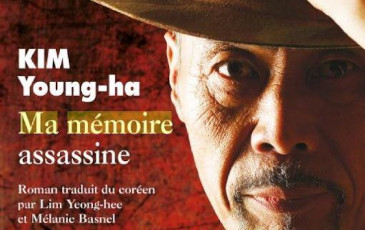Au cœur de la puszta – la grande plaine hongroise – les habitants d’une petite communauté villageoise en pleine déréliction attendent,
entre espoir et crainte, le retour d’Irimiás et Petrina, qu’ils croyaient morts. Irimiás, beau parleur, leur promet monts et merveilles tout en empochant leur argent. Petit escroc et mouchard de la police, il n’en est pas moins celui qui, portant leurs espoirs, les fera sortir de leur marasme, pour le meilleur ou pour le pire.
Jamais le mot « résumé » n’aura été si vain. Il pourrait ici désigner n’importe quoi, de la comédie satirique au mélo naturaliste. Or il dissimule un monstre. On n’a pas tous les jours l’occasion de tomber sur un monstre et même le cinéma, art forain par excellence, n’en compte pas tant que ça. Parmi eux, on citera Il est difficile d’être un dieu, d’Alexeï Guerman ou bien, plus récemment, les extraordinaires Malmkrog, de Cristi Puiu et La Flor, de Mariano Llinás. D’une certaine façon, Sátántangó les surpasse tous. Par sa durée (plus de 7 heures), par sa noirceur (double : un monde en ruine, boueux et battu d’une pluie continuelle mais aussi le noir charbonneux de la pellicule elle-même, qui sculpte les visages et magnifie les textures), par sa lenteur (chaque plan s’étire jusqu’à la limite du supportable), ce film est bien moins un spectacle qu’une plongée, une immersion totale dans un univers qui, peu à peu, vient doubler le nôtre en prenant une densité, une réalité – au sens le plus matériel du terme, dégagé de tout « réalisme » – qui demande à être vécue plutôt que simplement vue. Car ce film plein de non-dits et de mystères, en deçà des multiples grilles d’interprétation qui peuvent lui être appliquées, est d’abord et avant tout une expérience. Si, le plus souvent, le cinéma peut-être vécu comme une façon de s’abstraire pour un temps du réel, ce film-là vous y ramène, et parfois non sans violence. L’expérience se fait alors épreuve : par l’inconfort physique d’une si longue station, par la lutte qu’il faut mener par moments contre le sommeil, par la durée presque douloureuse de certains plans qui vous donne véritablement à vivre avec les personnages, par la violence, enfin, de certaines scènes, comme celle où l’innocente Estike maltraite et empoisonne un chat avant de se suicider (on ne sait pas pour Eskite, mais pour ce qui est du chat, on ne s’est visiblement pas embarrassé de trucages). Encore la notion d’épreuve peut-elle prêter à confusion, qui induit le plus souvent l’idée d’un dépassement, d’un au-delà auquel on accéderait après avoir triomphé des périls. Rien de tel dans ce film qui ne cesse au contraire de se boucler sur lui-même en un perpétuel va-et-vient d’un personnage à l’autre, d’un point de vue à l’autre. Le titre prend alors tout son sens : ce « tango de Satan », c’est la vie même, à l’image de cette scène hallucinante où les habitants, saouls comme des cochons, s’agitent sans fin au son d’une indigente ritournelle. La vie n’est qu’un tour de piste, une danse sans but ni signification, qui vous ramène au point de départ sans qu’il faille en attendre quoi que ce soit. Une vie dont il faut désespérer pour simplement la vivre, au point d’accepter de la revivre : vision très nietzschéenne de l’existence que Béla Tarr partage avec László Krasznahorkai, auteur du roman éponyme et complice de longue date du cinéaste, au point qu’on pourrait presque parler de symbiose tant leurs œuvres se nourrissent l’une de l’autre. Entamée en 1985 avec Sátántangó (qui ne sera toutefois terminé et montré qu’en 1994), leur collaboration se prolongera jusqu’au Cheval de Turin, en 2011, dernier film en date de Béla Tarr, véritable happening cinématographique et aboutissement controversé de cette idée d’éternel retour. Mais ce tango n’est pas seulement métaphorique. De même que le film est à vivre, il est aussi à danser. Et la caméra de vous enlacer pour vous entraîner dans de lents mouvements tournants, de longs travellings en plans-séquences interminables, en une chorégraphie qui ne manquera pas de rappeler le cinéma de Miklós Jancsó (Les sans espoir, Psaume rouge…) ou celui d’ Andreï Tarkovski mais aussi, de façon plus subtile, le théâtre dansé d’une Pina Bausch où s’agite souvent sans beaucoup plus de perspectives une semblable humanité.
Quoi qu’il en soit, ça chavire.
Yann Fastier