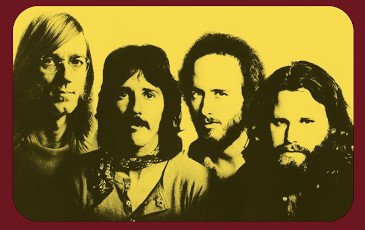Dans un premier roman très maîtrisé, David Lopez pose la question de l’appartenance et de l’enfermement.
Ce n’est ni tout à fait la banlieue ni tout à fait la campagne, juste une petite ville de la France dite périurbaine, comme tant d’autres. Une bande de jeunes gars zone entre les pavillons. Copains d’enfance et de quartier, à présent dans la vingtaine, ils s’emmerdent avec virtuosité : « L’ennui c’est de la gestion. Ça se construit. Ça se stimule. Il faut un certain sens de la mesure. On a trouvé la parade, on s’amuse à se faire chier ». Entre fumette intensive, palabres interminables et parties de cartes à rallonges, le temps s’immobilise, le territoire se resserre, rétrécit et finit par se refermer dans un confort précaire et sans horizon.
On ne cherchera pas d’intrigue plus « romanesque » à ce qui doit plutôt se lire comme un tour du propriétaire, une succession de vues imprenables sur l’aquarium où tournent inlassablement Jonas et ses amis poissons. Jonas est le narrateur. Boxeur, un petit peu plus talentueux que les autres, un petit peu plus lucide aussi, il se tient sur le seuil, bien conscient de mener sa vie comme il se bat : sans grande ambition, en cultivant l’esquive, de peur de prendre des coups. Mais est-il possible d’y échapper ? Pris entre deux combats, le récit ne répond qu’en creux, par les quelques ouvertures qui s’y font jour, comme autant de possibles fenêtres de tir. Ainsi, Lahuiss, le seul qui soit parti faire des études, quand il revient au pays « comme au parloir », apporte-t-il avec lui Voltaire et Céline. Ainsi Wanda, cette fille des beaux quartiers avec laquelle Jonas entretient une relation ambiguë, faite de sujétion et d’évitement, est-elle à la fois crainte et désirée comme une incarnation de toutes les frontières. Au fond, Jonas et les autres ne sont à l’aise qu’entre eux, sur leur propre terrain, dont ils ne cessent de réaffirmer les contours. Qu’ils en testent les limites sociales et géographiques en se frottant à la petite bourgeoisie locale ou qu’ils le magnifient à travers les saisons d’une enfance qu’ils n’ont jamais vraiment quittée, il s’agit toujours de ce même fief, qui vous sépare des autres autant qu’il vous en protège. Sous les postures de lascars, Jonas et les autres restent des enfants terrifiés par l’inconnu, à la manière de Robinson Crusoë qui court se cacher lorsqu’il découvre une première empreinte après des années de solitude : « (…) car jamais lièvre effrayé ne se cacha, car jamais renard ne se terra avec plus d’effroi que moi dans cette retraite » écrit De Foe, dans un passage que souligne Jonas au hasard d’une lecture. Cette retraite, c’est aussi la langue. Rarement la langue parlée aura été restituée avec autant de vérité dans un roman, de façon si naturellement lisible. Marqueur d’appartenance, elle aussi fait partie du fief. Elle aussi est une limite, comme chacun en prend conscience à sa manière au cours d’une hilarante et émouvante séance de dictée volontaire. Cette langue, qui sert à se reconnaître, peut-elle servir à se parler ? Et, d’abord, veut-on vraiment se parler ? « Dans ces ambiances, dès qu’il y en a un qui se met à parler de ses problèmes, il y en a un autre pour trouver que ce n’est pas marrant, ce qu’il raconte, et puis ça passe à autre chose. Ou alors on fait des blagues dessus. Ça ne court pas les rues les oreilles. »
Peut-on, dès lors, s’émanciper sans trahir les siens ? En-deçà de tout réalisme social, telle est l’unique question qui sous-tend ce très beau premier roman. Il ne s’agit à aucun moment de décrire un milieu, même de l’intérieur. Si la tendresse évidente de David Lopez pour ses personnages n’exclut pas la lucidité, le respect qu’ils lui inspirent lui interdit aussi de les juger ou même de chercher à les « comprendre ». Est-il Jonas ? Est-il Lahuiss ? Ni l’un ni l’autre ? Sans préjuger de sa propre biographie, il n’aura en tout cas trahi personne.
Yann Fastier