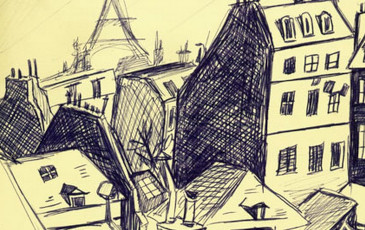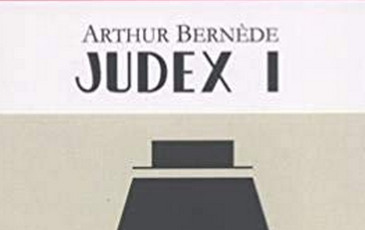Sous ce titre énigmatique se cache une montagne suisse.
Un beau bébé des Grisons de 2269 m, sur les pentes duquel semblent – tiens – s’agiter de petites silhouettes. Approchons-nous. C’est l’été sur l’alpage. L’armailli (le maître-fromager), son aide, le vacher et le porcher partagent un chalet avec veaux, vaches, cochons et couvées. Paysans, touristes, la bergère d’à côté… quelques visiteurs passent parfois et voilà pour le cadre parfaitement bucolique de ce qui relève cependant bien moins de Virgile que du très regretté F’murr. Car il passe un léger vent de folie sur cet alpage, qu’on ne s’étonnerait pas de voir chevauché par le même génie qui présidait au burlesque plus pyrénéen du dessinateur. En trois cents fragments, comme autant de vignettes, la comédie s’égrène au fil de la saison. Une comédie au pointillé, faite de courtes notations factuelles et qui ne se sent pas l’obligation d’être toujours drôle. L’est-elle d’ailleurs vraiment ? On hésite tant le rire y semble contenu, dans le double sens du terme : il est là sans y être, bien mieux porté par une sorte d’implicite imperturbable que par une quelconque mécanique du gag, et dont on peinerait à donner un exemple précis, sauf à citer in extenso :
« Des touristes arrivent dans leurs belles voitures sur le chemin qui a été refait au printemps dernier, et s’arrêtent à la clôture en klaxonnant. Ils klaxonnent en direction de la butte au-dessus du chalet, où le vacher et le porcher sont couchés dans l’herbe, ils font des signes, finissent par descendre eux-mêmes de leur voiture pour ouvrir la clôture, roulent plus loin, refont vingt minutes plus tard le même parcours en marche arrière parce que le chemin ne mène pas beaucoup plus loin et qu’il n’y a pas la place de faire demi-tour pour les grosses voitures, s’arrêtent devant la clôture, qu’ils avaient laissée ouverte et qui à présent est fermée, et ouvrent la clôture. Sur la butte, couchés dans l’herbe, les bergers saluent de la main les excursionnistes. »
Si l’humour est souvent au rendez-vous, il est, on le voit, fortement conditionné par des rapports de classes que l’on devine impitoyables. Sans qu’il soit encore question, comme au bon vieux temps, de castrer un valet de ferme en toute impunité, les paysans ont le sens des hiérarchies : « (…) après avoir trinqué avec l’armailli, serré la main à l’aide-armailli, tapé sur l’épaule du vacher et fait un signe de tête au porcher ». Juste retour des choses, les « bouèbes » ont souvent le beau rôle face à l’armailli pansu, plus amoureux de la bouteille que d’un métier fortement folklorisé. Flegmatiques et roublards, ils pratiquent la lutte des classes à leur manière. Trafiquant le beurre d’alpage avec les visiteurs dans le dos du patron, pillant le sac-à-dos des touristes en pleine furia photographique, ils s’abîment parfois dans une sorte d’extase qui les confond avec leurs bêtes et le paysage, dans une forme d’attention aux choses heureusement préservée de tout lyrisme artificiel par le laconisme de son expression. Ni psychologie ni jugements : le ton délibérément neutre de la narration met tout à plat – un comble dans ce contexte alpin – et fait confiance au lecteur pour décrypter l’ellipse et lire entre les lignes. Subitement devenu intelligent, le lecteur en redemande et il en aura, car outre la version française – traduction de Camille Luscher – cette édition trilingue ne le gratifie pas seulement de la version originale allemande mais aussi de la version romanche, langue natale de l’auteur, lui-même natif des Grisons. Premier volume d’une trilogie appelée à faire date, Sez Ner confirme au plan littéraire ce qu’en faisait déjà depuis longtemps la géographie : un sommet.
Yann Fastier