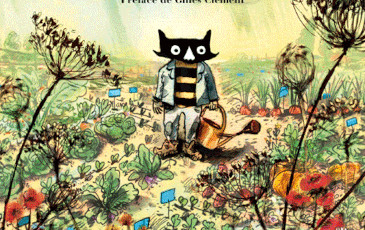Alby doit la mettre en veilleuse.
Il sait qu’il ne doit pas insulter, frapper, mettre le feu à des poubelles, défoncer à coups de poing portes et murs, mettre en danger ses passagers en roulant à tombeau ouvert… Mais voilà, Alby n’est pas correct. A trente ans, malgré ses dires, il est toujours incapable de tenir en place. C’est plus fort que lui, il faut qu’il la ramène, qu’il cherche et trouve les embrouilles, qu’il fasse mal. La violence est un repère fiable, clair, « elle signifie uniquement ce qu’elle veut dire : ‘à ce moment précis, je ne t’aime pas’ ». Autocentré, inadapté, toujours en train de justifier ses gestes et ses paroles, de louvoyer, Alby est insupportable. C’est, en tout cas, l’impression qu’il donne dans les premiers chapitres. Puis, au travers d’une écriture surprenante, faite de descriptions des détails de la vie courante, de l’énumération systématique de ce qu’il voit, se dresse, en creux, un personnage extrêmement attachant. Alby ne gère pas sa vie. Sa mère meurt d’un cancer, il ne comprend rien aux femmes, son père perd tout sens commun. Les événements lui tombent dessus, sans qu’il y puisse rien, et cette impuissance le rend dingue, malade, lui donne envie de tout péter, tout le temps. C’est par la violence qu’il existe, parce qu’il est en colère. C’est sa réponse à l’absurdité de l’existence. Ecrit à la première personne, ce livre est très étonnant, très fin. Si l’on suit la logorrhée d’Albert, c’est par les réflexions que les autres lui font et qu’il rapporte qu’on apprend qui il est. Un homme faible. Trop sensible. Le décalage entre ce qu’un être humain « normal » dirait et ce qu’il ose dire est irrésistible. Il ose tout. Il donne une note aux mots d’amour de sa copine. Il drague en demandant à une fille si « sa chemise est livrée avec des patins à glace. » Il n’a aucune pudeur, aucune limite. Il est bizarre. Ses réflexions révèlent un esprit vif et caustique, une sagesse inattendue : « le Temps est cancérigène, comme le bacon brûlé », « les effets secondaires de la Ritaline étaient nombreux – anxiété, irritabilité, patriotisme », « J’ai éprouvé du soulagement, comme si je venais de baiser, de pleurer ou de démissionner d’un boulot. » Alors, on se marre, on ricane. Il nous venge de nos petites lâchetés quotidiennes, de notre capacité à tout accepter, des « j’aurais dû dire ça ». On est avec lui, finalement. Et on prend conscience, au fil des pages, de notre propension à juger trop vite, à nous agacer de ceux qui ne sont pas dans la norme. Et si c’était nous, les simples d’esprit, les handicapés des sentiments ? La vie n’est pas plus calme avec lui, pas plus belle (le titre original du roman est Making Nice), elle est plus exaltante et drôle.
Marianne Peyronnet