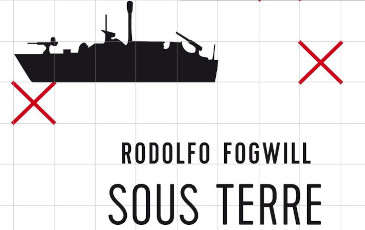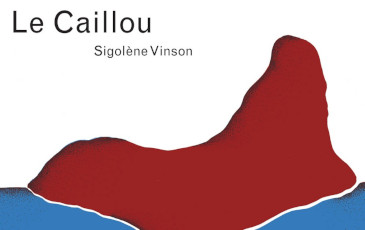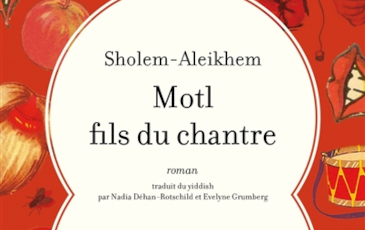Les personnages des nouvelles de Dorothy Parker se pensent grands.
Ils n’en sont, par contraste avec la réalité, que d’autant plus petits. Leurs rêves d’être respectés voire admirés de leur communauté sont anéantis par la mesquinerie de leurs (ré)actions, et s’ils ne s’en rendent même pas compte, le lecteur si. Briller, faire partie de la haute, être établis, les couples dont il est ici question n’ont que cette idée en tête et l’on prend un malin plaisir, tout comme leur créatrice a dû le faire en observant cette classe de parvenus de son vivant, à les savoir échouer.
Ecrits dans les années 20 par une femme libre, dépressive, alcoolique, divorcée, remariée plusieurs fois, qui a vécu (souvent mal) de son écriture et a fréquenté les cercles littéraires les plus infréquentables, les trois courts textes de ce recueil se lisent un rictus sur les lèvres, qu’une moue de dégoût vient parfois effacer, à la peinture de ces paires qui s’appellent « papa » et « maman », offrent des visages avenants et sont prêts à tout pour avoir l’air. Les fondations de leurs maisons en stuc sont posées sur des sables mouvants, tout comme leur union n’a aucune base solide. Paraître est leur raison d’être.
Monsieur Durant, en route pour retrouver femme et enfants, se félicite de s’être débarrassé de sa secrétaire et de son « problème ». Parce qu’entendons-nous bien, ce n’est pas parce qu’il a eu une relation avec cette femme de vingt ans et qu’il l’a mise enceinte que « le problème » de cette fille, fort moche finalement, est le sien.
Quel dommage ! que Grace et Ernest se séparent. Ils étaient tant heureux ensemble, dégageaient une telle harmonie. Tant pis si dans l’intimité, ils n’avaient rien à se dire et s’ennuyaient à mourir. Ils avaient l’air heureux et c’est tout ce qui compte.
Et que dire de Monsieur et madame Wheelock et de leur fille qui louche ? Un si joli petit tableau. Si « papa » se fait des films, imagine tout quitter sur le coup d’un « oh, et puis zut » à l’instar de cet inconnu dont l’histoire était racontée dans le journal, la morale est sauve, pour tout quitter il lui faudrait de l’envergure. Les voisins peuvent dormir tranquilles.
Suffisants, prétentieux, les hommes sont abjects et les femmes au foyer. Bonnes épouses et bonnes mères, du moins en apparences, puisqu’il convient de les respecter ces apparences de vertu et de moralité, dans cette classe qui se voudrait l’élite mais ne sera jamais que moyenne. Pas d’empathie pour leurs semblables de la part de ces individus à l’allure policée, pas d’empathie non plus de l’auteure envers ses créatures. Dorothy est féroce dans sa peinture de la mesquinerie mais elle les achève sans effets de manche, sans retournements de situation finale, par touches bien senties, délicates, à l’image de cette société qu’elle abhorre et dont elle reprend les codes.
Marianne Peyronnet