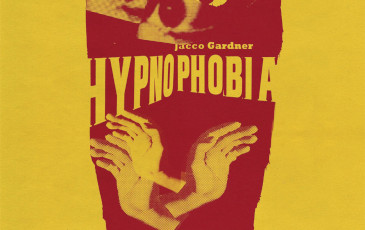L’histoire de Bone, le premier roman largement autobiographique - publié en France en 1999 - de Dorothy Allison, avait été un choc.
Elle y racontait, du point de vue de la petite fille qu’elle avait été, son enfance meurtrie dans une famille pauvre de Caroline du Sud, la violence, les viols perpétrés par son beau-père quand elle avait cinq ans. La dureté du propos appuyée par l’extrême sincérité de ce récit à hauteur d’enfant avait traumatisé une Amérique persuadée que ce genre de parcours était derrière elle, en même temps que la puissance du roman consacrait Dorothy Allison d’entrée comme une immense auteure.
Lesbienne, défenseuse infatigable de la cause LGBT, Dorothy Allison est connue désormais autant pour son implication dans tous les combats sociétaux ayant secoué les Etats-Unis depuis les années 60 que pour son œuvre, toujours dérangeante, militante, mêlant questions de classe et de genre.
Trash est un recueil de textes courts, écrits dans les années 80, excellents reflets de son style et des thèmes qu’elle se plaît à aborder. Ses héroïnes y sont à son image et abordent les différentes étapes de sa vie. Les études à l’université et la difficulté à s’intégrer dans un milieu si différent de sa condition d’origine. L’entrée dans la vie active et la découverte d’une sexualité considérée comme différente. La rage de mener son existence comme elle l’a décidé et le dégoût de se voir constamment jugée. La défense de ses sœurs les plus fragiles, homosexuelles et pauvres. La littérature comme exutoire et porte de sortie.
L’écriture est directe, efficace, ne s’embarrasse pas de périphrase que ce soit par dire le sexe ou revenir sur les éléments constitutifs de sa vie d’avant, sa vie de White Trash ou de gouine, insultes qui ont forgé sa colère, nourri sa force. Née en 49 d’une mère célibataire de 15 ans, la petite Dorothy a grandi dans un monde où les hommes, alcooliques, désœuvrés, avaient pour coutume de tabasser et violer femmes et enfants, où les filles devenaient mères de dizaines de gosses non désirés dont le poids accablant les condamnait à stagner dans l’extrême pauvreté, où ses cousins mouraient prématurément de maladies, d’accidents, de manque d’amour. « On était si nombreux (…) qu’on était innombrables. Comme des têtards. Si, de temps en temps, il en manquait un, qui donc tenait le compte ? (…) Ils et elles mouraient et ne manquaient pas. »
Elle exorcise ses démons, tue les fantômes dans ces nouvelles. Elle fait survivre aussi, le souvenir de cette mère qui a tenté de lutter et qu’elle ne pourra jamais détester. Elle fait le compte des humiliations subies, du mépris des bien-pensants envers ces cassos sales et feignants dont elle est issue. Elle se raconte. Elle bouleverse.
Marianne Peyronnet