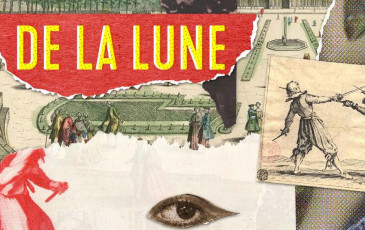Pour la plupart de ses lecteurs, Jirô Taniguchi (1947-2017) n’est rien d’autre que l’auteur paisible et contemplatif de L’homme qui marche, de Quartier lointain ou du Journal de mon père.
Au mieux le connaît-on encore pour ses histoires de montagne empreintes d’humanisme (Le sommet des dieux, Le sauveteur…) ou ses adaptations des récits naturalistes d’E. T. Seton. C’est ignorer que le mangaka préféré des Français eut à ses débuts une carrière beaucoup plus diverse, ne dédaignant aucun genre, jusqu’aux plus hard boiled. Ainsi d’Un assassin à New York, paru en 1991, alors qu’étaient pourtant déjà sortis L’homme qui marche et Au temps de Botchan (sur les écrivains de l’ère Meiji) qui devaient asseoir sa réputation en Europe. Sur des scénarios de Jinpachi Môri (Tajikarao, l’esprit de mon village), Taniguchi y donne corps et visage au formidable Benkei, faussaire de génie et, surtout, vengeur impitoyable expatrié dans la Grosse Pomme. Placide, massif (qu’on imagine une sorte de Lino Ventura japonais), Benkei, moyennant finance ou pour son seul contentement, élabore les châtiments les plus raffinés à l’encontre de diverses crapules qui croyaient s’en tirer à bon compte et ne se méfient pas assez de ce géant débonnaire qui semble pourtant en savoir assez long sur leur pedigree. Pour un œil, les deux yeux, pour une dent, la mâchoire tout entière : Benkei ne fait pas de cadeaux et ne craint aucun excès, dans une ambiance volontiers outrancière qui n’est pas sans rappeler le meilleur giallo (« Le haggis que vous avez mangé a été préparé… avec le cœur et le foie de votre fille. ») Il se mêle et se heurte d’ailleurs assez volontiers à la mafia, au grand dam de quelques apprentis parrains qui apprendront à leurs dépens qu’il ne fait pas bon agacer le gros nippon. L’un d’entre eux finit même empalé sur le rostre d’un espadon : il en meurt, heureusement, sans quoi ce serait L’homme qui marche en canard.
Yann Fastier