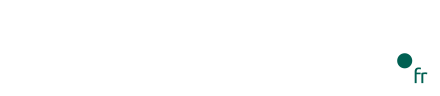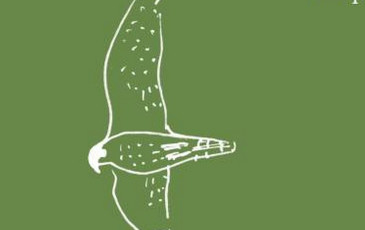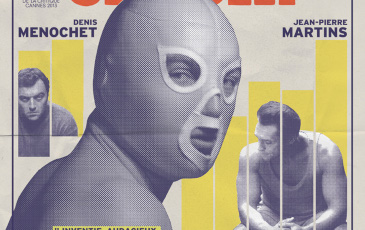Marcel Adrien, un jeune homme, se rend chez un étrange oculiste qui lui prescrit un régime propre à lui rendre la vue.
Entraîné par la force de ce traitement dans une errance labyrinthique où rien n’est vraiment ce qu’il paraît être, le narrateur se met en quête du secret du docteur Fohat, grand manipulateur et thaumaturge d’un monde crépusculaire où seule prévaut la logique des rêves.
Libraire et animateur de revues, poète proche de l’École de Rochefort, Marcel Béalu (1908-1993) fut également l’un des principaux représentants d’un certain Surréalisme d’après-guerre, un surréalisme d’atmosphère qui, sans toujours avoir reçu l’imprimatur d’André Breton, n’en constitue pas moins son plus beau chant du cygne. Maître incontesté du récit de rêve – ce dont il s’explique de belle façon dans La vie en rêves (Phébus, 1992) – Marcel Béalu n’avait pas son pareil pour mettre en mots ce qui, par essence, relève d’une certaine incommunicabilité. Qui n’a jamais fui tel ou tel ami, tel ou tel collègue s’évertuant à raconter ses aventures nocturnes ? Béalu, avant David B et quelques autres éminents oniristes, avait l’art de transmuer les songes en véritables contes fantastiques, mus par la poésie des mots et des images plutôt que par l’esprit mécaniciste du scénario bien ficelé auquel d’aucuns réduiraient volontiers le roman. L’expérience de la nuit est bien un roman mais il n’entend répondre à aucune logique sinon la sienne propre, parfaitement arbitraire, qui l’apparente à une longue dérive habitée, dont le battement sourd rappelle les récits d’un Bruno Schulz et d’un Alfred Kubin aussi bien que les films de Guy Maddin ou des frères Quay.
C’est un roman de 1945. Autant dire que ses 80 ans n’ont pas forcément fière allure sous leur reliure de toile verte élimée et leur inénarrable tampon « lecteurs avertis ». Sans doute fallait-il qu’ils le soient pour une lecture qui, sans rien qui pique les sens, dut être en son temps présumée « difficile » et restera d’autant plus minoritaire aujourd’hui que rien n’y engage – ni couverture clinquante ni d’autre résumé que le nom de l’auteur et le titre, en lettres dorées sur un dos peinant à les contenir.
Faut-il pour autant l’éliminer ? L’expérience de la nuit n’a connu qu’une seule réédition, chez Phébus, en 1990, dont nos collègues de l’époque n’ont pas jugé nécessaire de faire l’emplette et qui, à son tour, a cessé d’être disponible. Moins connu que L’aventure impersonnelle ou L’araignée d’eau, cet octogénaire vaut-il les 18 millimètres qu’il occupe dans la réserve à la place de quelque successeur plus fringant ? Au prétexte qu’il est un peu oublié, un auteur doit-il l’être encore plus par la disparition matérielle de ses livres ? Et le rôle du bibliothécaire conscient de sa tâche est-il d’enfoncer celui qui se noie ou bien de le réanimer comme nous tentons de le faire ici-même ? Le manque de place, certes réel, ne sert-il pas trop souvent de fin de non-recevoir à des questions que la routine de nos métiers conduit à ne même plus nous poser ? Guidés tout autant par la course à la nouveauté que par une logique comptable dont la prévalence reste à démontrer, ne jouons-nous pas sur les mots lorsque, pour justifier la gabegie, nous nous défendons de gérer une « bibliothèque de conservation » ? Entre la bibliothèque classée – vouée à la conservation d’un fonds ancien – et le simple comptoir de nouveautés auquel se réduit de plus en plus souvent la librairie, il y a un monde où les bibliothèques publiques, qu’elles soient municipales, intercommunales ou départementales ont à jouer un rôle primordial. Parce que les livres ne sont pas, ne seront jamais interchangeables, simples produits de consommation courante oubliés sitôt que lus ; parce que les livres d’hier sont ceux d’aujourd’hui et seront ceux de demain ; parce que d’un livre à l’autre tout se tient et se répond sans souci de l’achevé d’imprimer, ne renonçons jamais à notre mémoire et disons non à l’Alzheimer bibliographique que l’esprit du temps cherche à nous imposer.
Yann Fastier