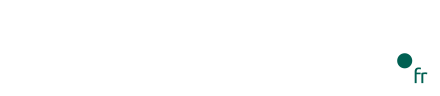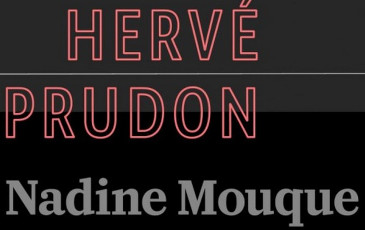Le 17 juillet 1851, le député Victor Hugo monte à la tribune pour prononcer son dernier discours.
Il durera près de quatre heures, au milieu d’une tempête de huées et d’applaudissements que ne renierait pas l’assemblée nationale actuelle.
En effet, depuis deux ans déjà, Hugo, qui l’a pourtant soutenu lors de l’élection présidentielle de 1848, lutte pied à pied contre les mesures prises par le gouvernement de Louis Napoléon Bonaparte, alors président de la deuxième république, qui essaie de restreindre le suffrage universel, la liberté de l’enseignement, le droit de réunion et la liberté de la presse. Napoléon arrive à la fin de son mandat de quatre ans, il doit obtenir une révision de la constitution lors d’un vote à l’assemblée nationale pour pouvoir supprimer la clause de non-représentation, et multiplie les attaques, soutenu par les légitimistes et les bonapartistes, pour discréditer les républicains et gagner les orléanistes à sa cause.
Après le discours de Victor Hugo, la bourse chute de 25 centimes, la publication du discours dans les journaux s’arrache à plus de 100000 exemplaires, et Napoléon perd le vote de l’assemblée. Il a épuisé tous les moyens légaux pour se maintenir au pouvoir, ne lui reste plus que le coup de force.
Le matin du 2 décembre 1851, Louis Napoléon Bonaparte édite 6 décrets : il dissout l’assemblée nationale et le conseil d’état, rétablit le suffrage universel masculin, convoque le peuple français à des élections pour plébisciter une nouvelle constitution qui établit un régime présidentiel autoritaire, et fait arrêter ses principaux opposants. Le soir du 3 décembre un arrêté est publié qui déclare que tout individu pris en train de construire une barricade ou les armes à la main sera fusillé. Dans la nuit 30000 soldats sont déployés dans les rues de Paris. Dans l’après-midi du 4 décembre, la troupe se rassemble et côtoie une foule de curieux et de manifestants. Les soldats s’affolent et ouvrent le feu, les maisons sont fouillées à la baïonnette, on compte plusieurs centaines de morts, dont des femmes et des enfants, la description que fait Hugo, minute par minute, du carnage, est saisissante. Les jours suivants, plus de 27000 personnes sont arrêtées, et déportées pour la plupart.
Le vote pour la nouvelle constitution, qui donnera tous pouvoirs au président, a lieu dans un véritable climat de terreur, où seuls les journaux favorables au « oui » sont autorisés à paraître, les listes électorales sont purgées des « mauvais électeurs », et des départements sont placés en état de siège, qui connaissent de véritables chasses à l’homme. Il sera un succès, avec la compromission de l’église et de certains parlementaires.
Victor Hugo tente, sans succès, d’organiser une résistance, mais sa tête est mise à prix, il fuit à Roubaix, puis à Bruxelles, où il écrira Napoléon le petit en un mois à peine. « Je n’ai pas l’intention de faire un livre » écrit-il, « je pousse un cri ». Prévu au départ comme une plaquette de quelques feuillets contre « Naboléon », le volume, qualifié de « plus éclatant pamphlet politique de toute l'histoire » aura 440 pages. Hugo restera 19 ans en exil.
Il faut imaginer les conditions de publication, le livre est édité par Hetzel à Bruxelles mais c’est un libraire-éditeur londonien qui servira de prête-nom, tandis que l’imprimeur remplacera lui aussi son nom par celui d’un collègue, et que le livre sera vendu en contrebande depuis Jersey, avec une fausse couverture. Les 8500 premiers exemplaires s’écoulent en quelques jours, les prix ne tardent pas à flamber, un exemplaire se vend 80 francs au lieu de 85 centimes. Les côtes de la Manche et les frontières de la Belgique et de la Suisse sont surveillées, les passeurs et receleurs risquent jusqu’à un an de prison. Très rapidement, plus de 300000 exemplaires sont écoulés, sans compter les contrefaçons et les traductions en anglais, allemand, italien.
Malgré cela, Louis Napoléon Bonaparte ne sera jamais vraiment mis en cause, il reste encore 18 ans au pouvoir.
Le livre, resté indisponible pendant 40 ans (hors œuvres complètes), a été réédité en 2007 dans l’excellente collection « un endroit où aller ». On est frappé par l’actualité et la modernité de ce récit, qui raconte comment on érode peu à peu une démocratie, avant de la piétiner, et qui résonne étrangement avec les périodes troublées que nous vivons, et avec certaines dérives autoritaires récentes.
Lionel Bussière