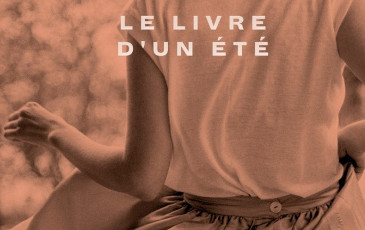La señorita Victoria Urquiza Iturbe vient de mourir.
Les meubles de la vieille demoiselle sont vendus aux enchères dans la maison même où elle aura passé sa terne et pieuse existence. C’est à cette occasion que la narratrice tombe sur son journal, dont la lecture fera l’essentiel du livre. On y découvre une âme tourmentée par l’amour. Celui que n’aura pas celle qui, très tôt, se sait laide. Celui qu’elle porte à son beau-frère, le bel Hernan. Celui, enfin, qu’elle éprouve pour son neveu, dont elle se rêve avoir été la vraie mère avant de lentement déchanter pour s’enfoncer définitivement dans l’irrémédiable.
Marcelle Auclair a 28 ans quand elle publie ce roman, tout juste rentrée du Chili de sa jeunesse, où son père, architecte, s’était installé en 1906. Journaliste, elle vient d’épouser l’écrivain Jean Prévost, en compagnie duquel elle fréquente une bonne partie du Tout-Paris littéraire. Mais son principal titre de gloire, outre une dizaine d’ouvrages trempés dans l’eau bénite, reste la création, en 1937, de Marie-Claire, référence obligée de toute la presse féminine d’après-guerre.
Rien d’anecdotique à cela, tant l’injonction permanente au bonheur domestique et conjugal éclaire a posteriori ce petit roman de mœurs que Laurence Campa, dans sa préface, s’essaye à défendre sans grande conviction. C’est qu’on n’y croit guère, à cette vieille fille à la fois trop intelligente et trop lucide pour n’avoir pas su se rendre aimable. Sous la punaise de bénitier perce la jolie bourgeoise, l’influenceuse en embuscade derrière la haridelle à qui elle semble souffler ses bons mots : « On voit que nous avons beaucoup pensé à l’amour, et que nous avons commencé à en médire », « Il faut avoir confiance dans l’avenir pour jeter les vieux calendriers »… À la même époque et sur le même thème, Marion Gilbert publiait Le Joug. En comparaison, celui de Marcelle Auclair est en balsa, capitonné de velours et ne manquera pas de faire fureur cet hiver à Megève.
Yann Fastier