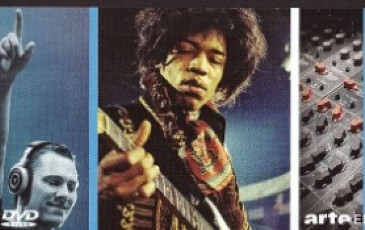Selon nos informateurs, on ne lit plus tellement Ernst Wiechert et c’est bien dommage.
En un temps où la bêtise et la barbarie gagnent chaque jour un peu plus de terrain, l’humanisme têtu de celui qui fut en son temps l’un des plus lus des écrivains de langue allemande garde toute sa force éthique, sans moralisme ni mièvrerie.
Il est vrai qu’il en avait vu d’autres : né en 1887 et mort en 1950, Ernst Wiechert aura traversé deux guerres mondiales et vécu la période nazie en « émigré de l’intérieur », opposant à l’idéologie nationale-socialiste une résistance passive qui lui vaudra tout de même un séjour à Buchenwald et fera de lui l’une des principales cautions morales de la nouvelle Allemagne, ayant su préservé son âme à travers les vicissitudes de l’Histoire.
S’il n’a ni l’ampleur ni l’ambition chorale des Enfants Jeromine ou de Missa sine nomine, ce Roman d’un berger, par sa concision et sa simplicité, constitue néanmoins une excellente introduction à l’œuvre de Wiechert. Il s’agit en réalité d’une longue nouvelle, extraite du recueil Hirtennovelle (1935), publié pour la première fois en français chez Stock en 1946, sous le titre La vie d’un berger, dans une traduction d’André Meyer et Charles Silvestre. On y trouve en condensé tout ce qui, d’un livre à l’autre, fera l’univers de l’écrivain.
Cet univers, ce sera tout d’abord un paysage. Celui de cette Prusse Orientale aujourd’hui disparue, partagée après la Seconde guerre mondiale entre la Pologne et l’URSS, terre de lacs et de bois à la beauté sévère dont on pourra se faire une idée grâce aux émouvants documentaires de Volker Koepp (Fleurs de Sureau, Froide patrie...), éclairés par les poèmes de Johannes Bobrowski, qui fut l’élève de Wiechert. C’est dans l’un de ces villages oubliés du monde que grandit Michaël, « fils d’une veuve », le berger du roman. Il n’a que six ans lorsqu’il assiste à la mort de son père, écrasé par l’arbre qu’il était en train d’abattre. Dès lors, il acquiert aux yeux de la petite communauté une réputation de calme et de courage qui pousse le maire à lui confier la garde du maigre troupeau du village. À la fois sûr de lui et bienveillant, il règne sur quelques fils de notables qui, loin de le snober, reconnaissent spontanément en lui une supériorité innée, bien au-delà des différences sociales. Au fil des années, il endosse ce rôle avec naturel et simplicité, son calme à peine troublé par l’irruption pataude d’une jeune femme peintre, émue par le chaste adolescent dont les yeux clairs « regardaient sans doute bien loin de là, dans un lointain passé (…) où la dignité royale pouvait encore se poser sur un front de berger ». Et c’est en nouveau Christ qu’il mourra au début de la Grande guerre, défendant contre des soldats la vie d’un agneau qui lui a été confié.
Car, au-delà de l’évocation d’une nature que Wiechert connaissait bien, c’est également et avant tout d’une certaine conception de l’humain qu’il s’agit. Adossée à un piétisme sans bigoterie, son œuvre est à tel point marquée par l’impératif catégorique qu’on pourrait presque parler à son propos de roman kantien. Ce n’est certainement pas un hasard si la capitale de la Prusse Orientale s’appelait autrefois Königsberg, dont l’auteur de la Critique de la raison pratique fut sans conteste le plus illustre citoyen. Il y a chez Kant et Wiechert un même arrière-fond culturel qui, théorisé par le premier et transfiguré par le second, tend vers un universalisme qui les élève au-dessus de tout soupçon. Ainsi, aussi enraciné soit-il, ne saurait-on juger Wiechert à l’aune d’un quelconque repli völkisch, quand son Roman d’un berger, élégiaque et mu tout entier par l’amour des humbles, est au fond au roman de terroir ce qu’une aria de Bach est à tous les cocoricos.
Yann Fastier