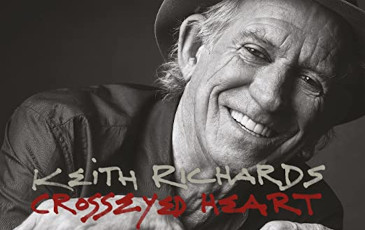1981. Ritchie, Colin et Roscoe, 18 ans, sont à l’aube d’une nouvelle vie.
Les premières images les voient, successivement, quitter leur environnement familial pour converger vers la capitale. Londres est l’endroit où il faut être lorsqu’on est jeune, avide de découvertes et de rencontres, et surtout homosexuel. S’ils ne se connaissent pas au début, rapidement ils fréquentent les mêmes clubs, s’apprécient et décident de partager un appartement. Ash et Jill se joignent à la troupe. La rumeur d’un cancer frappant uniquement la communauté gay commence à se répandre. Américaine d’abord, la maladie se rapproche, se propage, terrifiante, insidieuse, irréelle, jusqu’à toucher intimement le cercle des amis. La série suit leur parcours sur une décennie.
Au fil des épisodes, à travers ces portraits incarnés d’une génération fauchée par le VIH, on s’attache. Flamboyant, insouciant ou timide, multipliant les amants ou inhibé, chacun des personnages expose ses failles et ses espoirs lors de scènes sensibles au long desquelles on prend le temps de l’aimer. C’est cette proximité qui rend déchirant le chaos qui s’abat sur ces destins. Ces gamins en quête d’eux-mêmes, à l’orée de trouver qui ils sont, de se construire, en paix, dans la famille qu’ils se sont choisie, entourés de gens qui ne les jugent pas, se retrouvent en enfer. La fête est finie quand elle devrait durer. Ce n’est pas que de la peine que l’on ressent, c’est la rage qui fait couler nos larmes face aux injustices qui les frappent. La découverte du SIDA a été un moment éloquent dans l’histoire humaine. Qui a révélé la fabuleuse capacité des hommes à mépriser, haïr, écarter ce qui leur fait peur et qu’ils ne connaissent pas. En plus d’avoir dû affronter le rejet de leurs parents, surmonter la difficulté à s’assumer quand l’homosexualité est encore taxée de vice, Ritchie, Colin et Roscoe doivent faire face à toutes les idées reçues, tous les soupçons concernant leur sexualité. On dit le SIDA contagieux par simple contact. On le prétend sanction méritée, divine, pour avoir sombré dans la débauche. Les malades sont salis, victimes de la vindicte populaire et de l’indifférence des politiques sanitaires publiques en plus d’être condamnés.
Angels in America, réunissant Al Pacino et Meryl Streep, avait été une série bouleversante sur le même sujet, et tout le monde se souvient de Philadelphia ou encore des Nuits fauves. It’s a Sin, par sa longueur, l’inventivité de sa mise en scène, sa bo parfaite, ses acteurs remarquables impressionne, bouscule différemment. C’est la légèreté des personnages qui en fait sa force. C’est le contraste entre leur libération initiale, leur refus de céder à une normalité fade et le désir sociétal de leur faire payer leur faute qui donne envie de hurler. Touchés, ils ne s’agenouillent pas, ils continuent à rire et à rêver. A la volonté commune de les isoler, ils opposent leur fraternité, dont on ne doute jamais, en regardant It’s a sin, de faire partie.
Marianne Peyronnet