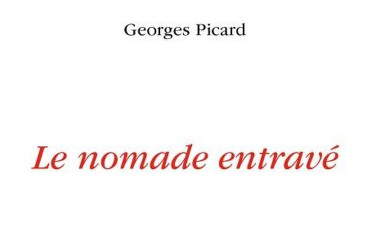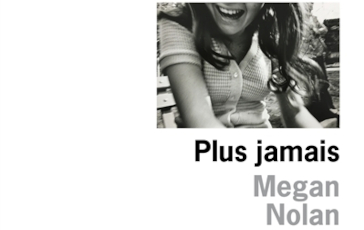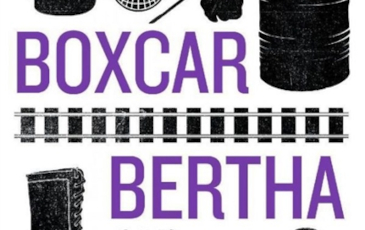1596, Stratford. Une petite fille, Judith, tombe soudainement gravement malade.
Son frère jumeau, Hamnet, part à la recherche d’un adulte qui pourrait la sauver. Dans les rues de la bourgade, il ne trouve personne de sa famille et revient auprès de sa sœur. Il sera emporté par la « pestilence » qui noircit l’avenir de la campagne anglaise.
Une époque. Un lieu. Un nom. De quoi intriguer. En exerce de son roman, l’auteure précise : « Hamnet et Hamlet sont en fait le même prénom, parfaitement interchangeables dans les registres de Stratford de la fin du XVe siècle et du début du XVIIe siècle. » Alors, on sait. Maggie O’Farrell va nous conter l’histoire d’Hamnet, fils oublié de Shakespeare, dont il fera une pièce quatre après la disparition et d’Agnes, un rien sorcière, surtout guérisseuse. Lui est instruit, enseigne le latin. Elle tire son savoir de la transmission, par les femmes, de remèdes trouvés dans la nature. Ils ont vécu une passion dévorante, au début, et ont eu trois enfants. Ils devaient quitter ce coin austère, mais une de leurs filles est trop fragile pour la ville, alors ils restent. Trop près de la belle-famille, du qu’en dira-t-on, de la violence du patriarche, ancien gantier ayant eu des revers de fortune. Dans cette promiscuité, le couple étouffe. Quand Hamnet meurt, il suffoque. Agnes demeure là, anéantie, sèche comme une des herbes qu’elle aimait cueillir, tandis que lui s’échappe, part, rejoint une troupe de théâtre à Londres, l’abandonne. De l’éloignement de son époux, Agnes souffre une deuxième mort. Comment peut-il songer à autre chose qu’à leur fils ? Ne compte-t-elle plus du tout pour lui ? L’incompréhension face à son manque de réaction, l’impression qu’il est indifférent à sa peine, qu’il n’éprouve rien, la transporte en enfer. Jusqu’à la scène finale, où elle prend conscience de leur peine partagée.
L’auteure ne cite jamais le nom de Shakespeare. Il brille par son absence. En se plaçant du point de vue d’Agnes, elle dresse avec force le portrait d’une épouse, autrefois sauvage, sensuelle, puis terrassée par la perte de l’amour et le deuil d’un fils. La ruralité est dure en cette période élisabéthaine, la vieillesse vient vite dans cet environnement où la mort est omniprésente. Il faut la puissance de la littérature pour transcender sa place dans le monde et trouver un semblant de paix.
Marianne Peyronnet