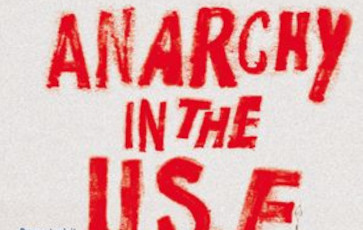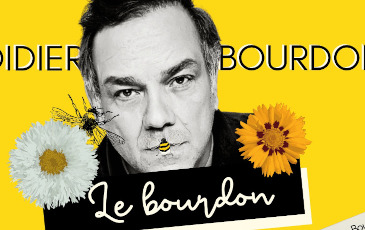Le marais : œuvres, 1965-1966. - Cornélius, 2020
Ils ne sont pas si rares, parmi nos prescripteurs et pédagogues, les esprits chagrins qui considèrent encore les mangas comme le divertissement favori des têtes faibles sans jamais en avoir ouvert un seul (ou bien dans le mauvais sens). Ceux-là mesurent mal la longueur d’avance qu’avaient les bandes dessinées japonaises alors même que les nôtres jouaient encore aux cow-boys et aux indiens ou enfilaient un slip sur leur Damart pour voler par-dessus les gratte-ciels. Dès la fin des années 50, le gegika, né des difficultés économiques et existentielles de l’après-guerre, faisait la part belle au réalisme, noir de préférence et, transcendant rapidement les genres auxquels il était d’abord astreint, s’épanouissait en récits d’une portée littéraire inédite. Le marché des librairies de location s’effondrant avec le retour de la prospérité, il lui fallait un nouveau support : ce fut le mensuel Garo. Lancé en 1964, Garo fut le laboratoire essentiel de la bande dessinée japonaise, auquel collaborèrent tous les grands noms du gegika, pour le faire évoluer, 68 aidant, vers l’avant-garde avec une vitalité, une passion dont le Pilote de Goscinny ou le Charlie mensuel de Wolinski peuvent seuls donner une vague idée. Yoshiharu Tsuge fut de toute l’aventure et, peut-être, l’un de ses représentants les plus singuliers.
Né en 1937, dans une famille pauvre, il doit travailler très tôt pour subvenir aux besoins des siens. Dès 1954, à 17 ans, il dessine en professionnel, alimentant en gegikas le réseau des librairies de location, aux côtés d’un Yoshihiro Tatsumi (L’enfer, Une vie dans les marges…), d’un Shigeru Mizuki (Kitaro le repoussant) ou d’un Kazuo Koike (Lone Wolf and cub). Le déclin inéluctable de cette petite industrie le mène cependant à la dépression (il est contraint à vendre son sang pour vivre), jusqu’à ce que Katsuichi Nagai, fondateur de Garo, lui remette le pied à l’étrier en l’invitant dans sa revue. Il en sera bientôt l’un des piliers, avec des nouvelles dont la plupart resteront des classiques et dont cette copieuse anthologie en trois volumes (pour l’instant), se veut représentative. Ainsi du Marais, qui voit un chasseur s’inviter dans une famille de la campagne et céder aux sollicitations sexuelles d’une fille étrange ou bien de La Rumeur, où, pour quelques sous, un pauvre hère se fait passer pour le grand duelliste Musashi Miyamoto. Les personnages, presque toujours, se tiennent à la marge – comme Tsuge lui-même le fut toujours – et leurs actes prennent place à la limite de l’inavouable : vols, escroqueries, agressions sexuelles plus ou moins fantasmées ou bien vécues dans la culpabilité, ils mènent leurs auteurs au bord de la folie, dans un climat d’inquiétante étrangeté qui, sans jamais basculer dans le fantastique, fait toutefois la part belle à la fatalité comme à l’inconscient.
Après une nouvelle crise existentielle qui le voit cesser de dessiner pour son compte et devenir l’assistant de Mizuki, Tsuge revient bientôt sous une forme renouvelée qui, avec La vis, va faire de lui le représentant de l’avant-garde en bande dessinée dans un Japon profondément marqué par les luttes étudiantes : s’affranchissant de tous les codes narratifs, La vis pourrait aussi bien être le récit d’un cauchemar qu’un simple collage hasardeux d’images réunies par une vague trame. Toujours prompt à s’auto-dénigrer, Tsuge lui-même a toujours botté en touche quand il s’est agi de s’expliquer sur la signification de ces cases. Elles deviendront pourtant ce qu’il faut bien appeler une pierre de touche, l’équivalent japonais d’Arzach de Moebius, dont on sait l’influence sur les générations qui ont suivi. À partir de là, les récits de Tsuge se font de plus en plus noirs, sans d’ailleurs toujours avoir à forcer sur l’encre de Chine. Ainsi, Divagation ou Souvenir d’été sont d’autant plus sombres qu’ils se déroulent dans la pleine lumière d’étés caniculaires, avec une économie de moyens qui force le respect. Quelques mots, quelques traits sont parfois suffisants pour évoquer, dans sa crudité nue, la force irrépressible d’une pulsion dont les effets ne seront pas jugés. Peut-on parler de psychanalyse dessinée ? Peut-être. Sûrement, même, dans le cas d’un homme qui ne sembla jamais dessiner que sous la contrainte, fut l’un des pionniers de l’autofiction en BD et reste pour toujours l’un des grands irréguliers d’un art que, décidément, Dragon Ball ne suffit pas à résumer.
Yann Fastier