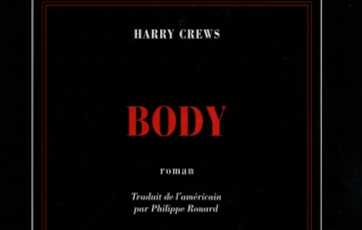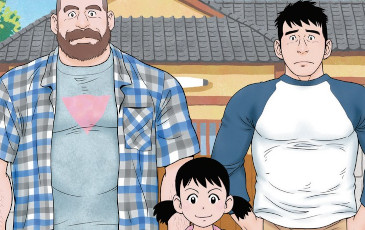Il arrive parfois que le critique, confondu, cesse de feindre :
non, il n’est pas ce Pic de La Mirandole arpentant en propriétaire les couloirs tortueux de la Littérature et, le plus souvent, sa connaissance de l’auteur qui lui échoit se réduit à sa fiche Wikipédia ou bien au prière d’insérer de l’éditeur. Tout rougissant, on l’avouera donc : on n’avait jamais rien lu de Goran Petrović, ni Soixante-neuf tiroirs (Le Rocher 2003), ni Le siège de l’église Saint-Sauveur (Seuil, 2006), ni Sous un ciel qui s’écaille (Les Allusifs, 2010), ni même Atlas des reflets célestes (Noir sur blanc, 2015). On ne sera pas donc tenté de leur comparer ces nouvelles, issues de différents recueils inédits en français et réunies sous le signe d’une identique tendresse. Car s’il y est bien question du temps, c’est avant tout sur le mode du souvenir et d’une certaine nostalgie de l’enfance, de celle qu’on éprouve à retrouver, sur de vieilles photos, des visages oubliés. C’est bien d’ailleurs un dispositif de ce genre qu’adopte l’auteur dès la première nouvelle où, à raison d’une photo par an, de la naissance à la vingt-deuxième année, s’élabore un « Jeu des différences » où ce qui nous apparaissait autrefois gigantesque finit par se réduire et se ratatiner aux dimensions trop étriquées du présent : « Et ainsi de suite, autour de nous tout s’amenuise, rétrécit, alors qu’en fait c’est nous qui devenons de plus en plus petits ou de moins en moins curieux, en tout cas toujours moins disposés à être séduits, et cela exactement à la vitesse à laquelle nous mûrissons ». Cette « disposition à être séduits », c’est elle qu’il s’agira donc avant tout de retrouver, d’une histoire à l’autre, entre évocations et anecdotes. La cour de l’immeuble était alors le centre du monde, peuplé de gens fascinants et supérieurs pour certains (« La cour »), quand on ne montait pas des expéditions clandestines – au risque des parents et des contrôleurs moustachus – pour aller contempler la statue d’une femme nue dans le parc de la ville voisine (« Cours additionnels de connaissance de la nature et de la société »)
Toutes les nouvelles n’empruntent pas, toutefois, à ce même registre d’indulgence amusée pour un pays perdu qui serait celui de l’enfance. Car ce pays se nommait également Yougoslavie et la guerre, une guerre innommée le plus souvent, une guerre « en creux », est néanmoins partout présente. Elle ne l’est jamais autant que dans « La Vierge, et autres rencontres » où, dans une petite gare de campagne où le train de l’Histoire a fini par s’échouer, la figure d’une jeune femme allaitant son bébé semble seule en mesure d’arrêter la barbarie montante : « La jeune femme posa son regard sur les soldats pour la première fois. Mais la douceur de son visage ne se dissipa pas. Elle les regardait comme si sa mansuétude n’avait aucune limite, vraiment aucune. »
Et c’est finalement cette mansuétude elle-même qui imprègne l’ensemble des nouvelles, jusqu’aux textes les plus métaphoriques, tel ce « Tableaux d’une exposition » qui voit les monochromes blancs d’une galerie très contemporaine se changer un instant en fenêtres ouvertes sur la vie ou bien « Tout ce que je sais du temps », qui donne son juste titre au recueil et où l’auteur, en douze chapitres, fait le tour du cadran pour évoquer la figure de son père à l’aide des différentes montres, pendules et réveils qui tictaquèrent leur commune existence, faite de bien plus de silences que d’aveux.
Tendresse, mansuétude, indulgence : toutes substances qui, n’en déplaise aux cyniques, ne collent pas aux doigts et n’empêcheront personne et surtout pas le critique ignorant mais définitivement conquis de se jeter incontinent sur le reste de l’œuvre de Goran Petrović. Qui, rappelons-le une fois pour toutes, n’a pas signé les musiques des films de Kusturica.
Yann Fastier