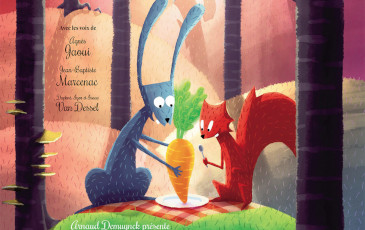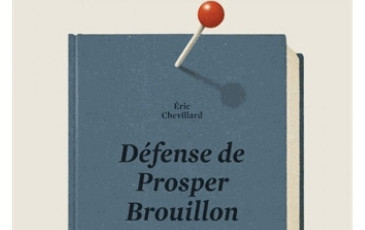« Celui qui silence » disait Alfred Jarry de Félix Fénéon dans son Almanach du Père Ubu et, certes, on ne lui donnera pas tort.
D’abord parce qu’à de rares exceptions près – dont ces Nouvelles en trois lignes – son œuvre reste encore largement inaccessible. Éclatée, dispersée en fragments innombrables, elle fut surtout composée d’articles et d’interventions diverses et parfois anonymes dans une foule de revues et de journaux dont il lui arriva d’avoir la responsabilité (La Revue blanche, L’en-dehors de Zo d’Axa pendant l’exil de ce dernier…) Ni poète, ni romancier, il fut critique avant tout, au point d’en incarner pour beaucoup la figure exemplaire, tant il eut de nez dans ses choix : l’un des premiers à soutenir les Impressionnistes et, surtout, les Néo-impressionnistes (Seurat, Signac…) il encouragera également un certain nombre d’hommes de lettres dont la réputation n’était pas gagnée d’avance (Verlaine, Gide, Mallarmé et tutti quanti). Enfin, s’il fut éditeur, jamais il ne chercha personnellement à publier le moindre livre.
Taiseux, donc, il le fut encore en cultivant – à l’oral comme à l’écrit – l’art de ne jamais trop en dire. À cet égard, jamais sans doute n’y parvint-il avec autant d’éloquence que dans la rubrique qu’il tint pour Le Matin de mai à novembre 1906. Sept mois, soit 1210 dépêches d’agence réduites à leur plus simple expression, selon la contrainte imposée par le journal. Banquets, cérémonies, prix de vertus, faits-divers surtout… chacun de ces tweets avant l’heure est en lui-même un roman, réduit à l’essentiel par un maître du raccourci : « Rue Myrrha, le fumiste Guinet tirait au petit bonheur des balles sur les passants. Un inconnu lui planta un stylet dans le dos. » Félix Fénéon ne fut pas seul à rédiger ces nouvelles, mais nul n’eut plus de talent que lui pour en éprouver l’épaisseur au-delà des faits bruts et, d’un mot, les faire passer du côté de la littérature.
Servis avec un flegme imperturbable, l’humour noir et l’ironie sont assez souvent de la partie : « Impossible d’éventrer le coffre-fort de l’horticulteur Poitevin, de Clamart. Dépités, les cambrioleurs incendièrent sa grange. » Cette distance qui, chez tout autre, passerait pour du cynisme, marque en réalité la mesure très exacte de la pudeur. Même en présence du plus horrible drame, Fénéon ne s’apitoie ni ne s’indigne, refusant au lecteur de le lui livrer « normalisé » par une sensiblerie de façade. Il n’est cependant pas bien difficile de deviner à qui vont ses préférences. Militant libertaire de toujours, il sera résolument du côté des pauvres : « Le mendiant septuagénaire Verniot, de Clichy, est mort de faim. Sa paillasse recelait 2000 francs. Mais il ne faut pas généraliser. » De même qu’en pleine séparation de l’Église et de l’État, il ne perd jamais l’occasion d’ironiser doucement sur ces maires qui tiennent à « restaurer le vrai Dieu » sur les murs des écoles ou bien sur les curés s’opposant manu militari à l’inventaire de leur église. Ainsi fait-il œuvre de moraliste, tout en se payant le luxe de ne jamais asséner aucune morale. Dépêche après dépêche, tout un petit théâtre prend forme. Un théâtre de l’espèce humaine en proie à ses passions, innocentes ou funestes qui rappelle aussi bien l’art du haïku qu’il préfigure – humour mis à part – le Témoignage de Charles Reznikoff, dans sa détermination à presser le trivial pour en faire sourdre la poésie.
Réunies pour la première fois par Gallimard en 1948 sous l’égide de Jean Paulhan, dont Fénéon fut le mentor, les Nouvelles en trois lignes ont connu bon nombre d’éditions, dont celle-ci, mise en page avec l’élégance et la créativité que l’on connaît à l’éditeur et qui remplace avantageusement toutes les autres.
Yann Fastier