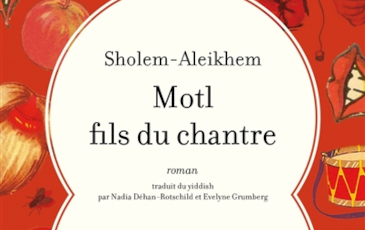La guerre de Sécession comme si vous y étiez.
Shelby Foote donne la parole à des soldats des deux camps, officiers et simples trouffions, pour raconter la bataille de Shiloh, l’une des plus sanglantes de la Guerre civile américaine. En matière de récit de bataille, le parangon de toute modernité reste évidemment celui de la bataille de Waterloo vécue par Fabrice dans La Chartreuse de Parme. Ce point de vue subjectif est au fond devenu le seul plausible et c’est aussi celui que l’on adopte ici, comme le seul propre à rendre la réalité de la guerre : un vaste bordel où personne ne sait très bien où est qui et qui fait quoi ni pourquoi, où tout peut basculer à tout moment, les plus téméraires céder soudain à la panique et le sort de la bataille se jouer sur un coup de dés. « Personne ne procéderait jamais de cette manière », raisonne ironiquement le soldat Robert Winter. « Ce serait trop confus. Qu’on écrive ou qu’on lise, on veut voir les choses du point de vue de ce gros Œil dans le ciel, comme si on était Dieu. » Dieu étant mort entretemps, Shelby Foote agit en romancier qui, s’il privilégie les trajectoires individuelles, sait aussi bien les croiser et les relier de manière à donner au bout du compte un tableau assez lisible et complet de la bataille. Car au contraire d’un Stephen Crane, dont La conquête du courage prenait prétexte de la Guerre civile pour démontrer l’inanité de toutes les guerres, Shelby Foote n’oublie jamais qu’il est aussi l’auteur de The Civil War, une somme historique de plus de 3000 pages : pas un bouton ne manque ici aux uniformes, pas une ligne, pas une phrase, pas un détail qui ne sonne comme un fait vrai, recoupé et vérifié. La grande force de Shiloh – ce qui en fait un classique étudié depuis longtemps dans les écoles américaines, même s’il est ici traduit pour la première fois – c’est précisément de parvenir à faire vivre cette érudition sans jamais la plaquer sur un récit dont l’humanité, dans toute sa misère et toute sa beauté, reste le ressort universel.
Yann Fastier