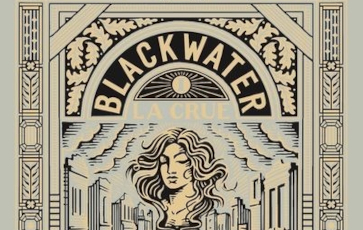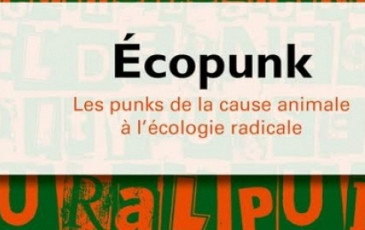Rares sont les écrivains sachant restituer l’âme enfantine sans niaiserie ni artifice.
Parmi eux, Mark Twain eut son Tom Sawyer et Sholem-Aleikhem (1859-1916) – qui passa en son temps pour le « Mark Twain juif » – eut son Motl. Âgé de cinq ou six ans au début du roman, celui-ci ne restera fils du chantre que le temps de devenir orphelin, avec une philosophie certaine et non sans y trouver quelque avantage. « Moi j’ai la belle vie, je suis orphelin » ne cesse-t-il de répéter avec un allant que nulle tribulation n’a le pouvoir d’éteindre. Elles ne lui feront pourtant pas défaut, non plus qu’à sa petite famille, rapidement jetée par la misère sur les chemins de l’exil à l’instar de ces milliers de Juifs d’Europe de l’Est et de Russie qui, fuyant les pogroms, quitteront la pauvreté familière et chaleureuse du shtetl pour tenter leur chance en Amérique.
Sa famille, c’est d’abord sa mère, aimante et constamment éplorée, puis son frère Elyè, peu avare de taloches et jamais à court d’expédients foireux, Brokhè, ensuite, la belle-sœur acariâtre, bientôt rejoints par tout un petit monde d’amis et d’émigrants dont le malheur est constamment tenu à distance par la candeur et l’optimisme irréductible du jeune narrateur en route pour New York. Il n’y parviendra pourtant pas encore au terme de ce premier volume, qui verra la famille bloquée en Angleterre (« un pays très sympathique, dit Brokhè, à part qu’il refuse de brûler ») en attendant de pouvoir embarquer à son tour.
À suivre donc, comme le veut la nature feuilletonnesque de ces courts récits parus dans la presse yiddish – langue à laquelle Sholeim-Aleikhem contribua pour beaucoup à donner ses lettres de noblesse – et qui, pour l’humour, le rythme et la concision, rappellent un peu leurs contemporains parmi les comic strips des journaux américains, une belle et forte dose de tendresse en plus.
Yann Fastier