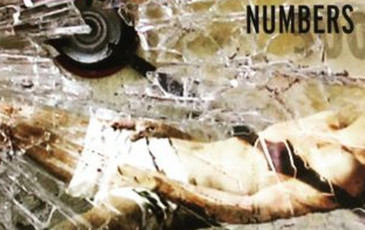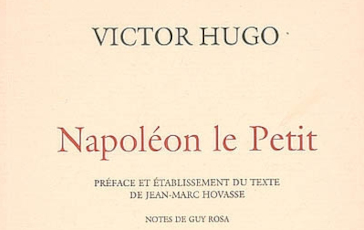Initialement paru en 1938 aux Etats-Unis, Une journée d’automne n’avait, jusqu’à présent, pas été traduit en français.
Erreur réparée par les éditions Gallmeister.
Le prologue plante le décor. Deux femmes s’apprêtent à assister aux funérailles du mari de l’une d’entre elles. Elles sont âgées, mutiques, rigides, semblent n’avoir pas d’émotions, elles sont « deux silhouettes noires décharnées pareilles à des corbeaux. » Il faut au lecteur quelques lignes pour comprendre qu’elles sont sœurs, ont respectivement 40 et 47 ans, et quelques chapitres pour saisir d’où vient la tension extrême qui tisse leur relation. Pour cela, l’auteur fait remonter son récit à des années plus tôt, quand tout a commencé.
La scène inaugurale, située dix-huit ans auparavant, offre un contraste saisissant avec le préambule. Elle présente Margaret Stuart, 29 ans, accompagnée de son époux, riche fermier de l’Iowa, attendant le train qui devait faire entrer Elspeth, sa cadette de sept ans, dans leur vie. Elle avait fait le voyage depuis l’Ecosse pour s’installer en Amérique, où son aînée menait une existence prospère et respectable. Les deux sœurs étaient si heureuses de se retrouver, alors ! Elles étaient si complices ! Opposées en caractères, Margaret plus austère, sensible au qu’en-dira-t-on, et Elspeth éclatante de fraîcheur, de spontanéité, leurs différences étaient complémentaires. La passion fulgurante qui unira Elspeth et Alec, le mari de sa sœur, et la découverte de cet adultère par Margaret, auront une influence durable autant que néfaste sur les trois personnages impliqués.
L’écriture, précise, simple, explore tour à tour les sentiments de chacun. Les deux femmes s’observent à la dérobée, n’échangent que le minimum de mots, tandis qu’elles sont détruites à l’intérieur par cette impossibilité à communiquer, rongées, l’une, calviniste, par son incapacité à pardonner, l’autre par sa culpabilité. Une journée d’automne est un roman sur le non-dit, exercice difficile en littérature, et sublimé ici, tant Wallace Stegner parvient à dévoiler l’intimité sans tout raconter, dans le portrait de ces femmes mourant à petit feu, se refusant à vivre. Le lecteur comble les blancs et les silences. Les saisons défilent sans que rien ne vienne perturber cette lente agonie, même la nature environnante de l’Iowa suspend son souffle, comme figée dans le souvenir de cette journée d’automne-là.
Marianne Peyronnet