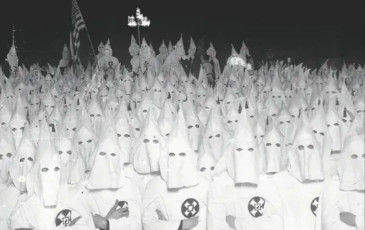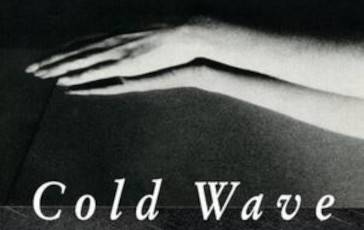Dès les premières phrases, on est dedans.
Dans cette pièce sordide à la déco défraîchie. Dans la peau de cette jeune femme blonde. Ligotée sur un fauteuil en cuir, aveuglée par le projecteur permettant à la caméra de filmer, accablée d’angoisse à l’idée de ce que ses deux ravisseurs vont lui faire, terrorisée de penser à ce qu’ils ont peut-être déjà fait à son mari et à son fils de quinze mois, déshabillée, puis…
Elle demande, pourquoi, pourquoi elle, pourquoi sa famille ? On lui répond parce que.
Dès le début, par la personnification de cette femme, pourtant jamais nommée, face à l’anonymat de ses bourreaux, il y a immersion dans une crainte diffuse, un malaise poisseux, sublimés par une narration au présent. La tension est habilement accentuée par le fait que l’issue semble déjà contenue dans le titre, le lecteur ayant ainsi (sans pour autant que le suspense en pâtisse) plusieurs longueurs d’avance sur la victime. Longueurs qu’il conserve tout au long de ce texte court, terriblement étouffant, puisque que tour à tour les deux tortionnaires se racontent uniquement pour les voyeurs que nous sommes. Ils s’incarnent en se remémorant leur passé, ils prennent une consistance en narrant leur parcours. L’exposé des horreurs qu’ils ont faites avant, le détail des pensées qui les rongent augurent du mal qu’ils s’apprêtent à commettre.
Sylvain Kermici donne des mots à la folie. Il dit les corps, les humeurs sales, les fluides sombres, les odeurs macabres. Il trouve comment figer la terreur, en creux, dans l’expression de détails aussi triviaux que l’observation d’un tapis usé sur lequel l’héroïne se focalise pour s’empêcher de se projeter dans les prochaines secondes, sans doute abominables. Il parle de la douleur sans forcer le trait. On ne voit rien des sévices supposés, on devine, à mesure que l’on perd la voix de la femme et qu’elle est remplacée par les pensées paranoïaques, malades de haine des hommes. Leurs cerveaux fourmillent d’idée torturées, fomentent leurs desseins sinistres, hurlent en dedans tandis que le silence du dehors, seulement perturbé par les aboiements sporadiques des chiens, s’abat sur ce coin de campagne désert. Et pourtant, au-delà de toute cette désolation, Kermici touche quand il parle de l’amour, dans l’évocation d’un banal baiser, dans la réminiscence d’une caresse toute simple, désespérante car à jamais perdue.
Que la femme a de la chance de ne pas entendre les pensées de ses ravisseurs, de ne pas connaître leur passé et leurs motivations ! Et que l’amateur de romans noirs, inventifs, maîtrisés, a de la chance, lui aussi, de n’avoir pas encore lu ce magnifique roman sépulcral !
Marianne Peyronnet