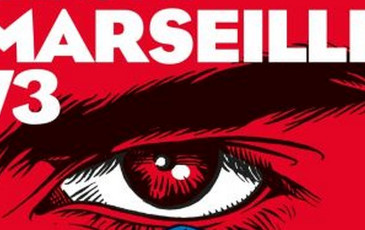Des baraquements dans le désert, au sud de la frontière mexicaine,
des masures infâmes faites de bric et de broc constituent l’architecture remarquable de cette ville fantôme connue des initiés sous le nom de Politoville. C’est un type qui raconte, au début, au présent. Tout est crade, ici. Il fait moite. Ça sent la sueur, le sang, ça sent toutes les odeurs dégueulasses qui s’échappent des corps, des vivants et des morts. Il est là parce que Harlan Polito l’y a envoyé, comme tous les autres gringos du camp, comme toutes les prostituées, toutes ces Maria ramassées dès leur plus jeune âge pour satisfaire le plaisir des hommes. Ça sent mauvais, dans tous les sens du terme. Alors, il faut qu’il se tire, le type, et vite. Le temps de dessouder ceux qui gênent, et salut la compagnie. Avec sa Maria. Qui, plus tard, quand elle aura eu son enfant, reviendra chercher le trésor planqué dans sa fuite, et constatera que les choses ont bien changé. Dorénavant, les chiennes féroces sont lâchées.
Pas besoin de faire long pour faire efficace. 120 pages denses, au style ramassé, au vocabulaire simple et concis, aux phrases courtes suffisent à planter le décor, à conter la révolte et la libération. Pas de gras, et pourtant la simplicité n’est qu’apparente. Ayres parvient à construire une œuvre plus complexe que la brièveté de son récit ne laisserait paraître. Dialogues imaginaires, changements de points de vue, retours en arrière, la narration avance à mesure que le lecteur suit le périple des Maria, meute d’anonymes, et se penche sur le destin particulier de certaines d’entre elles, enfin dotées de prénoms. Histoire effrayante, implacable, nimbée de mystère, Les féroces dégage le parfum exaltant de la vengeance, dans des scènes d’un réalisme effroyable, et fonde un mythe, celui de déesses cruelles rendant leur justice inflexible, méthodiques dans leur rage, d’une sauvagerie sans mesure, et pourtant capables d’un amour immense, pour peu qu’on le mérite.
Marianne Peyronnet