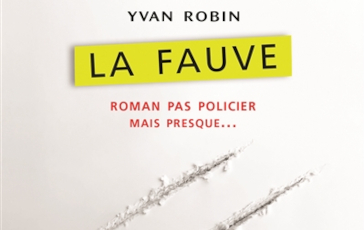Adapté d’une nouvelle écrite en 1865 par l’écrivain russe Nikolaï Leskov, « The young lady », premier film du britannique William Oldroyd oscille entre tragédie shakespearienne et thriller familial.
Que peut-il advenir d’une jeune femme au fin fond de l’Angleterre profonde ayant pour seule compagnie sa femme de chambre et subissant les épisodiques visites d’un mari au comportement douteux et d’un cruel beau-père ? Nous sommes en 1865. Katherine vit dans le Sussex abandonnée par l’époux et subissant stoïquement les railleries du parâtre hargneux et méprisant qui lui reproche tous les jours le fait de ne pas enfanter. Elle s’ennuie ferme, passant ses journées à somnoler ou à errer dans une maison froide et silencieuse. Cela pourrait être le début d’un film romantique de la BBC : le personnage féminin étouffe sous le carcan des conventions miné par une langueur proche de la dépression. Les premiers temps du film illustrent d’ailleurs son état par une succession de longues scènes où l’on suit Katherine dans sa déambulation solitaire de pièces vides en pièces vides. Cette mise en scène, sobre et élégante, façon « visite de musée », fait sourdre l’ennui latent d’une vie ponctuée uniquement par les rituels liés à la toilette du matin et du soir. Ces effets de répétition, tout en illustrant l’enfermement mental, laissent subtilement présager au spectateur l’imminence d’une catastrophe. Le déraillement fatal sera finalement provoqué par la torride passion que la jeune femme va vivre avec un employé de maison, qui, outre le fait d’être un subalterne, est également, sacrilège suprême, un homme noir probablement issu d’une des nombreuses colonies de l’Empire Britannique de l’époque. En effet, transposé dans le cadre sociologique de l’Angleterre des hobereaux du 19ème siècle (quand la nouvelle de Leskov était ancrée dans le monde des petits marchands russes), le thriller sexuel prend une dimension supplémentaire en s’enrichissant d’une réflexion sur le colonialisme et la condition féminine miroirs l’un de l’autre. A la fois coupable et victime donc, l’héroïne semble avoir autant de points communs avec Emma Bovary qu’avec Lady Macbeth. Et pourtant elle n’en reste pas moins une implacable tueuse en série. Mais la grande différence avec la tragédie de Shakespeare, c’est peut-être l’empathie bien plus grande ressentie par le spectateur pour une femme peut-être moins avide de pouvoir que d’amour et de liberté. Il faut insister ici sur le jeu de la comédienne Florence Pugh qui réussit l’exploit de nous offrir une fantastique image du mal. Hitchcock aurait adoré !
Cécile Corsi
A lire aussi :
La Lady Macbeth du district de Mtsensk/ Nikolaï Leskov