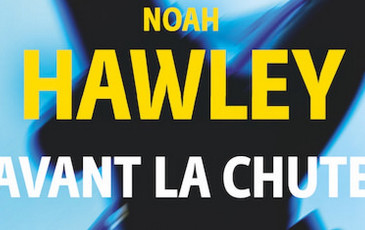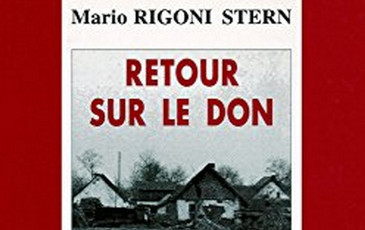On ne se prend pas tous les jours un monument littéraire en travers des dents.
Ni même, pour commencer, un monument d’histoire littéraire : paru en 1968, Le devoir de violence fut le premier roman écrit par un Africain à recevoir le Renaudot. Son auteur, Yambo Ouologuem, un jeune enseignant d’origine malienne, fut d’abord célébré urbi et orbi avant que des soupçons de plagiat ne viennent entacher la réputation de son œuvre. S’ensuivit une affaire aux ramifications complexes comme seuls les milieux littéraires en ont le secret et dont les répercussions finirent par écœurer l’écrivain, qui rentra au Mali et se maintint dans un silence obstiné jusqu’à sa mort, l’année dernière. Toute polémique éteinte, le Seuil réédite aujourd’hui ce roman, unique en son genre à sa sortie et dont le temps passé permet aujourd’hui de mieux mesurer l’importance.
Unique en son genre, tout d’abord par son ambition : véritable fresque, s’étalant sur plusieurs siècles, Le devoir de violence est avant tout la chronique d’un empire imaginaire, le Nakem, dominé par la dynastie des Saïfs, de sa fondation, au XIIIe siècle, à une « décolonisation » problématique où perdure tout un système profondément corrompu, qui ne cessa d’ailleurs de fort bien s’accommoder du vainqueur.
Car Ouologuem n’épargne guère les Africains eux-mêmes, et c’est encore ce qui fit le caractère exceptionnel de son livre en un temps – moins de dix ans après les indépendances africaines – où le discours victimaire était de mise et où l’on se devait de tout autant célébrer la négritude que la liberté retrouvée. Ouologuem, lui, ne craint pas de faire grincer quelques dents : le pouvoir des Saïfs trouve largement son compte à trafiquer des esclaves avec le Blanc et se maintient, sous la tutelle coloniale, à coups de meurtres et de prévarications de toutes sortes. Si le colonisateur n’est évidemment pas épargné (il est aussi bête et brutal que l’on peut s’y attendre), l’auteur réserve toutefois ses coups les plus inventifs aux notables africains, infiniment retors et manipulateurs et dont l’intelligence même ne sert jamais que leurs intérêts personnels, au détriment de ceux du peuple : « Puisqu’il fallait que la loi française fût faite pour quelqu’un, les notables la firent être pour le peuple, qu’ils levèrent en masse et expédièrent sur les chantiers des colons, le long des routes, voies ferrées et grands travaux. Et le Blanc les crut alliés ! » Un peuple, toute une « négraille » de serfs et de sans-grade, pour laquelle Ouologuem garde une évidente indulgence. Ainsi du doux esclave Kassoumi, amoureux de la belle Tambira, qui lui donnera, entre autres enfants, ce Raymond Spartacus Kassoumi dont la dernière partie nous fera suivre l’exil et l’errance.
Pour bien compléter ce tableau exemplaire du destin de l’Afrique, il lui faut en effet la transporter en France, où l’incarne cet étudiant besogneux, déraciné, représentant d’une génération « (…) la première des cadres africains, tenue par la notabilité dans une prostitution dorée (…) », et formatée pour servir de marionnette à l’inusable maître du Nakem. C’est de loin la partie la plus poignante du roman, celle que l’on devine la plus personnelle et la plus imprégnée de souvenirs, sans que le sentimentalisme l’emporte cependant jamais sur la raillerie.
Car il faut bien le souligner : au-delà de l’analyse lucide, impitoyable, du destin de tout un continent, Le devoir de violence puise avant tout sa force dans un style tendu de bout en bout par une ironie rageuse qui ne se refuse rien, ni la violence la plus extrême, ni le sexe le plus cru. Echafaudage baroque où, comme dans la vraie vie, magie noire et politique font assez bon ménage, c’est aussi une éblouissante démonstration de verve. Une verve dont les soupçons de multiples emprunts qui pesèrent un temps sur le roman ne doivent pas faire négliger la puissante originalité. Habile forfaiture ou bien exercice précurseur de sampling littéraire, Le devoir de violence n’en reste pas moins et quels que soient les outils qu’il emploie, un très grand roman africain.
Yann Fastier