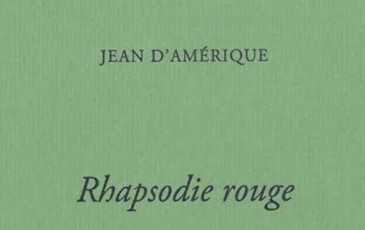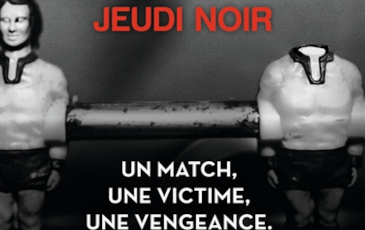Le lierre est une plante envahissante, imprévisible et même un rien désespérante mais il habille admirablement les ruines.
On pourrait en dire autant de cette première traduction française de l’auteure, née et morte Claus Beck-Nielsen avant de renaître en 2011 sous le nom de Madame Nielsen, artiste et performeuse en renom de la scène danoise. Insinuante, entêtante, digressive et capricieuse, sa prose toute en méandres pourrait agacer de prime abord si l’on ne comprenait bientôt qu’il s’agit d’abriter un tombeau. L’été infini aura été ce moment de grande innocence, au début des années 80, où un groupe de jeunes gens formant une sorte de petite communauté autour de la mère de l’une d’entre eux pouvait s’imaginer que cette union, cette mystérieuse entente, durerait toujours. L’amour, le bonheur, la réussite artistique, tout leur était dû et tout procéderait nécessairement de cette acmé. Il n’en sera évidemment rien, la réalité reprenant ses droits avec une indifférence cruelle, face à laquelle il n’est d’autre arme que l’ironie qui tient les défaites à distance. De l’ironie, la vieille femme qui raconte cette histoire et qui, peut-être, était ce jeune garçon qui est peut-être une fille mais ne le sait pas encore, cette vieille femme, qui donc est peut-être l’auteure, n’en manque pas. S’il s’agit bien pour elle de composer un requiem, c’est avec un apparent détachement qui jamais ne cède à l’élégie. Ce faisant elle invoque les mânes de la baronne Blixen (avec laquelle elle n’est pas sans cultiver une certaine ressemblance physique) : le lecteur français songera davantage à quelque version mise à jour du Grand Meaulnes, où un mal que l’on n’osait alors nommer se chargerait, comme il le fit pour beaucoup, de siffler la fin de la partie, de l’enfance et de toute illusion.
Yann Fastier