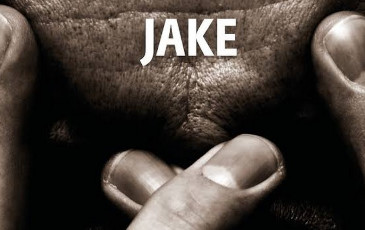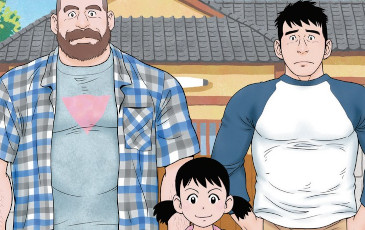2008. Afghanistan. Kaboul. Al-Qaïda. Talibans.
Pour chacun d’entre nous, ces noms évoquent des images lointaines et pourtant familières, bercés que nous avons été par un flot discontinu, pendant des mois, de reportages et de bulletins d’information sur cette drôle de guerre, dans ce coin du monde. Des images de paysages lunaires, caillouteux, secs et froids sur lesquels les Américains se cassaient les dents, et les Russes avant eux. Des images d’attentats, de femmes grillagées de bleu, d’enfants pleurant des larmes de poussière.
La lecture de Pukhtu réveille ces images vues tant de fois qu’elles avaient fini par faire partie de notre décor, banalisées, puis remplacées par des images d’autres conflits, dans d’autres coins du monde. Loin des yeux de l’info, loin du coeur. Oubliées les afghanes martyrisées, remplacées par Alep assiégée. DOA resitue avec une minutie obsessionnelle les enjeux du conflit afghan, les différents protagonistes, les jeux d’alliance. Mais Pukhtu n’est pas un traité historique, ou géo-politique, autant documenté soit-il. Sa force tient à sa nature même, le roman. L’exactitude des faits, le décompte des victimes, les scènes ô combien réalistes de décapitations, d’attaques de convois, d’opérations militaires ne sauraient déchiffrer un conflit auquel on ne pouvait pas tout comprendre il y a huit ans déjà. Trop de mensonges, trop d’approximations, trop d’infos parcellaires ou bidonnées. Si DOA donne des pistes, elles sont imbriquées, mouvantes et complexes. Pukhtu n’explique pas : la guerre n’est pas compréhensible.
Pukhtu ne juge pas, il incarne. Il met des noms et des visages sur ceux qui n’étaient que des ombres ou des nombres. Il donne des vies aux victimes comme aux bourreaux, il dit leurs espoirs et leurs buts. Il commet l’exploit de nous faire oublier une documentation faramineuse pour nous faire « ressentir ». Et ça fait très mal. Une attaque de drone, au présent, en direct. Le ronflement d’un moteur lointain, qui enfle, survole une petite fille, lâche ses bombes et la pulvérise. Peur. Si loin de là, aux manettes de l’avion sans pilote, des militaires formés jouent au jeu vidéo et dégomment des méchants. Joie. Des barbouzes, déjà morts à l’intérieur, vendus au plus offrant, profitent du conflit pour mettre de l’argent de côté, et de l’opium. Adrénaline. Une pute défigurée à l’acide par son mari car elle n’enfante que des femelles. Une journaliste enlevée, violentée. Un gamin soldat violé. Une gamine de riches paumée, camée, violée elle aussi. Un père fou de douleur d’avoir perdu sa fille qu’il n’a pas le droit d’aimer. Un flic au grand coeur. Des ministres véreux. Un mercenaire en quête de rédemption…. Des pions aux quatre coins du globe dont la vie est insignifiante aux donneurs d’ordre. La mondialisation de l’effroi comme si on y était. L’humanité dans toute sa diversité. Avec un point commun : un désespoir infini. Rien n’est simple, tout est tragique. C’est ça, la guerre. L’homme est un loup pour l’homme, et surtout pour la femme. Et des scènes pleines de lumière, des scènes d’amour qui laissent à genoux. Car oui, dans tout ce cloaque, cette absolue douleur, l’amour existe. Il est meurtri, rare et précieux. Il est universel.
Une guerre chasse l’autre. Quand une guerre est-elle finie ? Quand devient-elle de l’Histoire ? Qu’en-est-il de notre capacité d’empathie envers ceux qui souffrent quand ils sont si nombreux ? DOA aura su faire naître des êtres inoubliables. C’est ça, la littérature.
En tout cas, la guerre d’Afghanistan aura pour moi à jamais deux visages, ceux de Badraï et Storay.
Marianne Peyronnet