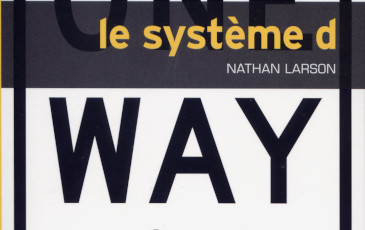Pâques 1976.
La famille Smith, très pieuse, part en pèlerinage dans le Lancashire sur la côte ouest au nord de l’Angleterre. Dans le Loney, plus précisément. C’est un lieu entre rivières et mer. L’eau est partout. A la marée montante, elle recouvre les terres si vite et si puissamment qu’on ne compte plus les noyés. Les Smith s’y rendent tous les ans et y louent Moorings, une vieille bâtisse humide, sans confort, qui convient à l’expiation des péchés. Pour y faire pénitence. Pour prier Dieu d’un miracle. Le miracle de guérir Hanny, le fils aîné de la famille, retardé mental.
Les Mortes-Eaux est un récit sombre et macabre qui exploite avec intelligence les ressorts du roman gothique. Narrée par un seul personnage, le cadet des Smith, jamais nommé, et dont on doute parfois de la stabilité psychique, l’intrigue fait appel à la mémoire de cet unique témoin, à ses souvenirs cauchemardesques de cette terrible semaine.
Les journées, rythmées par les prières et les rituels morbides d’une mère fanatique, sont languissantes : « je me suis souvent dit qu’il y avait trop de temps là-bas. Que ce lieu en était malade. Qu’il en était hanté. Le temps ne s’y écoulait pas comme il aurait dû. Il n’avait nulle part où aller, aucune modernité derrière laquelle courir. Il s’accumulait comme les eaux noires dans les marécages et, comme elles, il restait là et stagnait. »
Les nuits sont terrifiantes. La pluie, le vent frappent la masure tels des fantômes désireux d’y pénétrer. Les bruits du dehors laissent envisager le pire. Des cris, des coups de feu tirés par des paysans frustes et haineux ? L’intérieur n’est pas plus rassurant, animaux empaillés, candélabres d’un autre siècle, pièce qui dissimule des secrets…
Le coin est bercé de superstitions, de légendes et de rites effrayants. Le narrateur assiste au combat que se livrent païens et chrétiens, autochtones et touristes. Qui arrivera à soigner Hanny, et à quel prix ?
Le récit s’enfonce dans une noirceur absolue aux relents fantastiques, se fait le relai des croyances d’un autre âge, distille des mystères qui hantent toute une vie. La langue, d’un classicisme digne d’un roman d’Ann Radcliffe, servie par une belle traduction, s’accorde au désespoir et à la solitude des protagonistes, comme dans l’extrait suivant exprimant le désespoir d’un prêtre qui perd la foi : « Alors, cela lui apparut. Il s’était trompé du tout au tout. Dieu était absent. Il n’avait jamais été ici. Et s’Il n’avait jamais été ici, dans ce lieu précis, alors Il n’était nulle part. (…) Ici, la vie surgissait d’elle-même et sans raison particulière. Elle se poursuivait sans témoins et mourait sans laisser de souvenirs. (…) On venait de lui montrer la religion parfaite. Celle qui n’avait pas besoin de foi. Et il n’y avait pas non plus de paraboles pour enseigner ses leçons, parce qu’il n’y avait aucune leçon à enseigner. A part une seule : la vacuité de la mort. Elle n’était pas un seuil, mais un mur, contre lequel l’ensemble de la race humaine s’empilait comme un tas de débris rejetés sur un rivage. »
Marianne Peyronnet