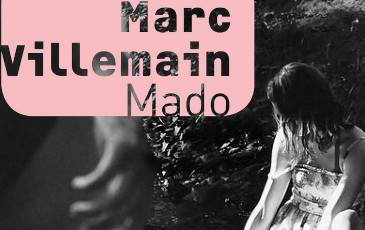John Devine est né un soir de tempête, dans un village paumé au fin fond de l’Eire.
Sa mère l’a appelé John, du nom de l’apôtre préféré de Jésus, celui qui a écrit le livre de l’apocalypse, celui qui n’a pas fini en martyr. Bercé aux récits bibliques nimbés de légendes irlandaises contés par la douce voix maternelle, John a grandi. Il a quinze ans cet été. Il est solitaire, désenchanté. Sa lecture d’un traité de biologie sur les parasites tourne à l’obsession, lui évite de penser à l’avenir. L’âge adulte ne lui dit rien qui vaille. Un immense corbeau noir plane dans son ciel, assombrit ses rêves. John a peur. Sa mère semble atteinte d’un mal incurable. Trop de tabac, trop d’alcool. Elle s’affaiblit. Elle le laissera seul, bientôt. Sa rencontre avec Jamey Corboy, jeune dandy amoureux de Rimbaud, le propulse dans l’adolescence avec son lot d’expérimentations : cigarettes, whisky, petites puis grosse bêtise. Les ailes du corbeau n’ont jamais autant occulté la clarté solaire.
John l’apocalyptique est d’une beauté troublante. Si les thèmes de l’amitié, de la transmission, de l’amour filial sont bien présents, il déborde le cadre du simple roman d’apprentissage. La narration évite de fixer l’intrigue dans une période réellement définie. John aurait pu naître il y a longtemps. Il pourrait naître demain. Ses craintes sont universelles, simplement humaines. Les références constantes aux mythes celtes et catholiques enveloppent le roman d’une étrangeté extatique, dans une ambiance crépusculaire de fin du monde accentuée par la proximité d’une nature souvent hostile. Empreint d’onirisme, il dépeint avec une grande justesse les tourments de John contraint d’abandonner son enfance, ce monde d’insouciance et de contemplation. On a tous ressenti une fois au moins, à la tombée du jour, une angoisse fugace, presque animale, un sentiment de perte inexpliqué. C’est cette sensation, cette mélancolie puissante heureusement passagère, qui transparaît à la lecture du livre de Peter Murphy.
Marianne Peyronnet