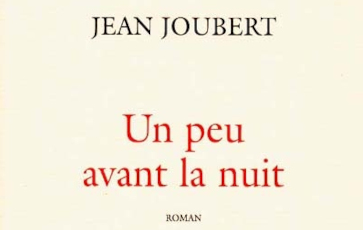Qui, mieux que Bruno Heitz, pouvait faire une adaptation de La guerre des boutons digne de ce nom ?
Tout le monde connaît La guerre des boutons, classique indémodable de la littérature stratégique à l’usage de la jeunesse qui, dans une France rurale d’avant les monuments aux morts, voit s’affronter deux bandes de gosses à grands coups de lance-pierre et de torgnoles. Depuis 2010, l’entrée dans le domaine public du roman de Louis Pergaud n’a évidemment pas manqué de susciter une salve de nouvelles adaptations plus ou moins opportunes dont pas une seule, au cinéma comme en bande dessinée, ne sera cependant parvenue à éclipser la plus connue d’entre elles, celle d’Yves Robert en 1962. A la fois populaire et bon enfant, celle-ci ne renvoyait cependant qu’une image assez édulcorée de la véritable violence qui traverse le roman, violence sans doute vécue comme bénigne à l’époque mais dont la moindre des multiples roustes paternelles suffirait aujourd’hui à déclencher l’intervention toutes sirènes hurlantes des services de protection de l’enfance. Il appartenait donc à Bruno Heitz de restituer, au plus près de la lettre et de l’esprit, un récit qui, décidément, semblait n’attendre que lui. Qui d’autre, en effet, depuis Benjamin Rabier, aura eu dans le monde des littératures graphiques une telle intelligence de la campagne, un aussi réel talent d’observateur, un style, enfin, aussi bien accordé à la verve rabelaisienne de Pergaud ? Des 9 volumes de son Privé à la cambrousse au Roman de Renart, de ses innombrables histoires de loups aux agrestes aventures de Louisette la taupe, Bruno Heitz a accumulé sur son CV suffisamment de petits coins de verdure pour faire de lui l’un des très rares ayants-droit légitimes d’un romancier qui, quelles que soient les probables réticences du hussard noir qu’il fut à l’encontre des « illustrés », se serait certainement reconnu mieux que partout ailleurs dans cette grosse centaine de pages d’un noir et blanc sans chichis. Rarement dessin, en effet, se sera constitué avec un tel naturel en une véritable écriture, à la fois fluide et précise, capable d’évoquer en quelques traits l’atmosphère d’un lieu, d’une époque, d’un milieu, là où la majorité des soutiers qui font l’ordinaire de la bédé s’épuisent en un « réalisme » vulgaire et parfaitement calcifié à force de détails inutiles. Une écriture, surtout, qui se souvient de ce qu’elle doit au peuple et à l’enfance et ne renie jamais sa famille, celle-là même qui vit naître François Rabelais et Georges Brassens, Etienne Jodelle et Louis Forton, Michel Audiard et René Fallet, La Fontaine et San Antonio, tous francs-rimailleurs et conteurs impénitents dont on aimerait tirer le portrait à l’ancienne, avec voile noir, éclair de magnésium et petit oiseau qui va sortir. Gageons que Bruno Heitz y figurerait en bonne place, l’œil malicieux comme il sait faire, bras-dessus-bras-dessous avec le cousin Pergaud, parmi la vaste et joyeuse ribambelle de tous ceux qui, au fil des siècles, n’auront cessé de cultiver avec amour la belle jeunesse de notre langue.
Yann Fastier